Les causes de la Première Guerre Mondiale
Par Georges Brun
Publié le 20 mai 2015
« … Elle était merveilleuse, cette vague tonique qui, de tous les rivages de l'Europe, battait contre nos cœurs. Mais ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l'Europe charriait aussi des nuages. L'essor avait peut-être été trop rapide. Les États, les villes avaient acquis trop vite leur puissance, et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou à en abuser. La France regorgeait de richesses. Mais elle voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien qu'elle n'eût pas assez d'hommes, et de loin, pour peupler les anciennes. Pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L'Italie voulait la Cyrénaïque, l'Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie ; et l'Allemagne, encore tenue à l'écart, serrait déjà les poings pour y porter un coup furieux. Partout, le sang montait à la tête des États, en portant la congestion.
La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout, en même temps, comme s'il s'agissait d'une infection bacillaire, à se transformer en désir d'expansion. Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s'engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons - les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton, les paysans hongrois contre les serb0s, les grands trusts les uns contre les autres ; la conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage.
Si aujourd'hui on se demande à tête reposée pourquoi l'Europe est entrée en guerre en 1914, on ne trouve pas un seul motif raisonnable, pas même un prétexte. Il ne s'agissait aucunement d'idées, il s'agissait à peine de petits districts frontaliers ; je ne puis l'expliquer autrement que par cet excès de puissance, que comme une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s'était accumulé durant ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque État avait soudain le sentiment d'être fort et oubliait qu'il en était exactement de même du voisin ; chacun voulait davantage et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus : notre commun optimisme. Car chacun se flattait qu'à la dernière minute, l'autre prendrait peur et reculerait ; ainsi, les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. Quatre fois, cinq fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s'en tint au jeu ; mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. En Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre ; en France, on prolongea la durée du service ; finalement, les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d'où les nuages approchaient déjà de l'Europe. »
Stefan Zweig (1881-1942), Les rayons et les ombres sur l'Europe, 1944, éd. posthume.
Sommaire
- Introduction
- I Impérialismes et partage du monde
- II Les crises du capitalisme
- III Le jeu des alliances
- IV Les nationalismes
- V La course aux armements
- VI Tensions internationales et crise des Balkans
- VII La crise de juillet 1914
- Conclusion
Retour à Les combats
Introduction
A bien des égards, le premier conflit mondial est inexplicable : voici un continent en pleine expansion économique, sociale, culturelle, intellectuelle, un continent en plein progrès, qui a tout à gagner au maintien de la paix, cette paix qui depuis 40 ans lui a permis de dominer le monde entier et d’offrir à sa population un bien être inconnu jusque-là et des promesses d’avenir radieux, avec des perspectives de développement illimitées, voici ce continent, l’Europe, qui, en l’espace de quelques années va s’engager dans le conflit le plus sanglant, le plus terrifiant de l’histoire de l’humanité, alors que rien, absolument rien ne justifiait une telle conflagration. Ce « suicide collectif » d’une société de plus de 400 millions d’hommes, reste à bien des égards une énigme et pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses satisfaisantes à ses causes.
Autant les causes du second conflit mondial apparaissent clairement, - choc d’idéologies messianiques et faillite des démocraties -, autant celles de la « Grande guerre » apparaissent multiples, floues, incohérentes et absurdes…au point de diviser nombre d’historiens et de critiques :
• certains y voient la volonté de puissance et de domination de l’Empire allemand de Guillaume II, jugée principale responsable du conflit ;
• d’autres, la responsabilité collective d’états impérialistes et colonialistes ;
• d’autres encore une conséquence logique et fatale de la domination du capitalisme mondial engendrant la concurrence des nations ;
• quelques-uns l’expliquent par le jeu des alliances, « jeu » qui à un moment donné dérape sans que personne ne puisse ou ne veuille l’arrêter ;
• un choix délibéré de régimes autocratiques face à la montée de très sérieuses tensions sociales internes ;
• l’exacerbation des patriotismes, des rancœurs nationalistes, des revendications minoritaires et indépendantistes et la montée des idéologies pangermaniques, panslaves, panturques
• La concurrence économique et commerciale de plus en plus vive que se livrent les puissances européennes dans le monde entier pour s’approprier marchés et débouchés
• La nature humaine, la fatalité, un hasard malheureux, une évolution trop rapide de la société provoquant un emballement rapidement incontrôlable

Le capitalisme constitue une des causes principales de la guerre. Représentation syndicale (Industrial Unionism, 1911) de la structure hiérarchisée, pyramidale et de classe du capitalisme, incluant l'importance du soutien de l'armée ou de l'industrie de l'armement et du clergé.Affiche anglaise.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Voici quelques citations intéressantes :
« Le fait est que les hommes dans leur grande majorité sont prêts à considérer, du moins en certaines circonstances, que le recours aux armes est une démarche légitime. Ce peut être le désir d’enrichir sa communauté et d’exalter son amour-propre... Ces considérations nous rappellent que la guerre est dans la nature humaine. »
Robin Prior et Trevor Wilson, La Première Guerre mondiale : 1914 – 1918. Atlas des guerres. 2001. Robin Prior et Trevor Wilson sont des historiens enseignant à l’université d’Adélaïde, spécialistes des questions militaires et le la première guerre mondiale.
« La situation diplomatique en 1914 - avant Sarajevo - nous semble autoriser les conclusions suivantes : on peut admettre qu'aucun gouvernement ne voulait de propos délibéré la guerre européenne. Mais l'obsession de la guerre les hantait tous, rôdait en eux et autour d'eux, à l'exception (peut-être) du gouvernement britannique. D'une part les malentendus et la méfiance étaient au plus haut point chaque groupe attribuait à l'autre des projets d'agression et agissait en conséquence ; chacun se jugeait en état de légitime défense et travaillait hâtivement à compléter son outillage de guerre. D'autre part, chaque groupe avait tendance à se croire le plus fort, par suite chacun acceptait le risque de guerre, chacun était décidé à ne pas reculer d'un pas devant l'autre. De ces gouvernements, maîtres absolus des destinées des peuples (en droit ou en fait), le plus impatient d'agir, parce qu'il se jugeait au bord de l'abîme (ne se disant pas qu'il l'avait creusé de ses propres mains), était le gouvernement autrichien ; celui qu'assaillaient les tentations les plus troubles, que servaient les agents les moins scrupuleux, le plus convoiteux mais le plus vacillant, était le gouvernement russe ; le plus anxieux de l'avenir, mais le plus confiant en sa force présente, le plus enclin à user de la force par tradition bismarckienne et sollicitations innombrables, était le gouvernement allemand ; le mieux préparé et le mieux servi (diplomatiquement), moralement aussi le plus prêt, le plus en garde, le plus résolu, était le gouvernement français, étant le seul que guidât une main ferme. »
Jules Isaac, Un débat historique. Le problème des origines de la guerre. Rieder, 1933. Jules Isaac (1877-1963) est un historien français, auteur, à la suite d'Albert Malet, des célèbres manuels d'histoire, usuellement appelés « Malet et Isaac ».
« Plus un évènement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser du point de vue de ses causes. »
François Furet, 1927-1997.
« La question des causes de la guerre de 1914 est d’une extrême complexité et, dans une large mesure, il reste une part de mystère dans la manière dont les puissances européennes se sont laissées glisser vers la catastrophe. »
Stéphane Audouin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18 : retrouver la guerre, Gallimard 2000. Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme. Il a fortement contribué à renouveler l'historiographie de la Première Guerre mondiale.

Le partage du "Gateau chinois": Caricature politique française de la fin des années 1890. Une galette représentant la Chine est partagée entre Guillaume II, Victoria du Royaume-Uni, Nicolas II de Russie, la Marianne française et l’Empereur Meiji du Japon. Illustration du supplément du "Petit Journal", 16 janvier 1898. Bibliothèque nationale de France
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
«Si quelqu'un cherche des causes simples, ils sera ou bien déçu, ou bien il réduira tellement la perspective historique que tout cela n'aura plus de sens ; le monde de 1914 était incroyablement complexe !»
Michael Neiberg. Neiberg est historien spécialiste de l’histoire militaire, professeur au Center for the Study of War and Society de l’université du Mississippi.
« Lorsque vous vous penchez sur l'été de 1914, vous devez examiner les décisions et erreurs humaines qui ont été faites, et je crois que jusqu'à la toute dernière minute, la guerre aurait pu être évitée, et qu'ils auraient très bien pu passer à travers 1914, un autre moment de crise, et ne pas avoir de guerre. »
Margaret MacMillan, The War That Ended Peace : The Road to 1914, Allen Lane, 2013. (Traduit en français, 2014, sous le titre "Vers la grande guerre : Comment l'Europe a renoncé à la paix"). Margaret Olwen MacMillan est historienne et professeur à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, où elle est directrice du St. Antony's College.
Il apparaît donc clairement que les causes de cette guerre sont multiples et qu’elles révèlent la complexité du monde en 1900, d’autant que ces causes sont souvent imbriquées les unes aux autres. Aussi est-il indispensable d’exposer les lignes directrices ayant conduit au conflit, d’analyser les principaux buts de guerre des divers belligérants et de dégager leurs responsabilités dans l’engrenage des événements ayant amené à la grande déflagration.
I Le choc des impérialismes et le partage du monde
« Les grandes puissances industrielles, les grandes banques et les grandes entreprises voulaient de nouvelles colonies – ou des semi-colonies sur lesquelles elles auraient exercé un contrôle indirect – pour leurs matières premières, leur main-d’œuvre bon marché et leurs possibilités d’investissement. Ici réside certainement l’une des principales raisons de la guerre. »
Jacques Pauwels, historien, professeur à l’Université de Toronto, Canada.
Jusqu’à la Conférence de Berlin initiée en 1884 par le chancelier Bismarck, deux grandes puissances, Grande Bretagne et France, se sont taillé des empires coloniaux, ne laissant aux autres pays que des miettes (Le roi des Belges s’adjuge le Congo, le Portugal a sa zone d’influence au Mozambique et en Angola...) Bismarck, obsédé par l’équilibre européen dont l’Allemagne serait l’arbitre et le garant, s’investit très peu dans la question coloniale, encourageant même la France dans cette aventure, pensant la distraire de son ardent désir de revanche.
Mais dans les années 1880, la pression des élites industrielle et militaire conduit le "chancelier de fer" à modifier son approche des questions coloniales. Dès 1883, un chapelet de territoires en Namibie est acquis par les Allemands, ce qui provoque la fureur anglaise et néerlandaise… Puis l’Allemagne prend pied au Togo, Cameroun, Afrique Orientale et Nouvelle-Guinée ; dans le même temps, naissent des tensions à propos du Congo entre Belges, Français, Anglais, Portugais, et en Tunisie entre France et Italie, en Egypte que l’Angleterre s’adjuge en 1882 au grand dam de l’Empire Ottoman et jusqu’en Turquie où l’Allemagne obtient d’importantes concessions en Anatolie.

Représentation de la conférence de Berlin en 1884. Adalbert von Rößler,Allgemeine Illustrierte Zeitung..
Montage. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
C’est alors que Bismarck réunit la conférence de Berlin (Octobre 1884 – janvier 1885). Cette conférence ne partage cependant pas l'Afrique entre les puissances coloniales : elle ne fait qu'établir les règles de ce partage, avivant encore les tensions entre colonisateurs, ouvrant une concurrence sans merci, aiguillonnée par les besoins de plus en plus impérieux des grandes puissances en débouchés et matières premières.
Cette rivalité est encore exacerbée lorsque le jeune empereur Guillaume II « débarque » le chancelier de fer le 18 mars 1890 et change totalement de politique : désormais, c’est la « Weltpolitik », la politique de domination du monde, qui est à l’ordre du jour à Berlin. Voulant sa place au soleil, et si possible la première, l’Allemagne ne pouvait que susciter un accroissement des tensions entre tous les impérialismes nationaux, d’autant que le développement de sa puissance industrielle, financière, commerciale, militaire et son capitalisme agressif gagnant de nouvelles parts de marché sur les cinq continents deviennent de plus en plus contradictoires avec les intérêts de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie (Balkans), mais aussi des Etats-Unis en Amérique du Sud et du Japon en Chine, nouvel et prometteur eldorado pour tous les impérialismes.
Aussi, la dernière décennie du XIXè siècle et les années 1900-1910 donnent lieu à de nombreux affrontements coloniaux où impérialistes, suscitant partout une sombre inquiétude et provoquant tensions politiques, ententes et alliances que d’autres évènements ne feront qu’exacerber… Quelques incidents sont particulièrement significatifs :
1. Le télégramme Krüger
En 1894, le riche homme d’affaires Cécil Rhodes (1853-1902), premier ministre de la colonie anglaise du Cap et fervent défenseur de la création d’une Afrique anglaise « du Caire au Cap », obtient l’aval du gouvernement anglais pour contrôler le Transvaal, république boer indépendante, très riche en or, dirigée par Paul Krüger (1825-1904). Il organise avec son ami Leander Starr Jameson (1853-1917) un raid privé (500 hommes) afin de renverser la république boer. Déclenché le 29 décembre 1895, le raid échoue lamentablement le 2 janvier 1896. Suite à cette affaire, Rhodes sera obligé de démissionner.
Profitant de l’occasion, l’empereur Guillaume II adresse le 3 janvier 1896 à Paul Krüger un télégramme de félicitations pour avoir repoussé l’incursion britannique sur son territoire : « Ich spreche Ihnen Meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, daß es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Volke gelungen ist, in eigener Tatkraft gegenüber den bewaffneten Scharen, welche in Ihr Land eingebrochen sind, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren.“ (« Je vous exprime mes sincères félicitations pour avoir réussi, sans avoir demandé l'aide des puissances amicales, vous et votre peuple, à repousser avec vos propres forces les bandes armées qui avaient envahi votre pays, et à avoir maintenu son indépendance contre l'agression étrangère. »)

Cécil Rhodes, Paul Krüger et Leander Jameson.
Montage. Montage Georges Brun à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Ce télégramme suscite une vague de protestation en Angleterre et affecte sérieusement les relations entre les deux puissances. La référence à l’aide de puissance amicale est interprétée comme une intervention allemande potentielle. La reine elle-même, par ailleurs grand-mère du Kaiser, répond à son petit-fils et manifeste son indignation. Peu de temps après, l’Angleterre se retire de la « Mittelmeerentente », un traité signé par l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre en 1887 garantissant notamment les intérêts des cosignataires contre la Russie et la France.
Le télégramme Krüger marque le premier incident sérieux entre les deux puissances et le début d’un ressentiment durable entre les opinions anglaise et allemande.
2. Fachoda

Photo des officiers et sous-officiers français de la mission Congo-Nil (1886-1900) arrivés en Abyssinie en1899, après la traversée de l'Afrique et l'épisode de Fachoda. Assis de gauche à droite le lieutenant Largeau, le docteur Emily et le capitaine Germain. Debout au deuxième rang le sergent Venail, l’interprète Landeroin le capitaine Baratier, le commandant Jean-Baptiste Marchand (1863-1934), chef de l'expédition et l’enseigne de vaisseau Dyé. En arrière-plan, le lieutenant Fouque, le sergent Dat et le lieutenant Charles Mangin, l’un des futurs chefs de guerre du premier conflit mondial.
Photo. Auteur inconnu, armée française., 2015
En 1898, les relations franco-britanniques ne sont de loin pas aussi amicales qu’elles ne le seront 10 ans plus tard. Le contentieux franco-anglais est séculaire et reste sérieux en cette fin de siècle : la « Perfide Albion » et un thème très populaire en France « La perfide Albion qui a brûlé Jeanne d’Arc sur le rocher de Sainte-Hélène. » (Christophe, La Famille Fenouillard).
En juillet 1898 la mission française du capitaine Marchand, partie du Congo français deux ans plus tôt afin de réaliser, au profit de la France, la liaison Dakar-Djibouti, vient occuper le village de Fachoda au sud Soudan. En septembre, remontant le Nil après avoir vaincu la rébellion mahdiste, les canonnières et les 3 200 hommes du prestigieux lord Kitchener arrivent en vue du poste français. Qui des Anglais ou des Français cédera la place ? La possession du Soudan et la continuité des empires coloniaux sont en jeu. Or, le bouillant Kitchener ne compte pas laisser des « Européens quelconques » interdire à l'empire britannique le contrôle du Nil, de son delta à ses sources... Après quelques vaines négociations, les Britanniques établissent un blocus autour de la place de Fachoda et la crise, de locale, devient internationale. Les relations entre la France et le Royaume-Uni se tendent à un point qui fait craindre, l’espace d’un instant, un conflit armé.

L’incident de Fachoda vu par le caricaturiste anglais politique de JM Staniforth. Le professeur Paul Barbier de l'University College de Cardiff tente de désamorcer les désaccords opposant Marianne et John Bull. Caricature du 24 octobre 1898.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Sommé d'évacuer Fachoda, le nouveau ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé (1898-1905), finit par s'incliner devant l’ultimatum anglais : le 7 novembre 1898, Marchand reçoit l'ordre d'évacuation. En France, cette reculade choque l'opinion, gagnée au nationalisme. Le 21 mars 1899, un accord colonial consacre la perte, au profit de l'Angleterre, de la totalité du bassin du Nil, y compris le Bahr el-Ghazal. L’Angleterre, de son côté, renonce à ses ambitions marocaines.
La reculade de Delcassé ne doit pas tromper : le ministre français voit beaucoup plus loin : son véritable objectif est la recherche d’alliances afin de rompre l’isolement de la France face aux ambitions allemandes et de bouleverser l’équilibre européen au détriment du second Reich. L’abandon du Soudan aux Anglais jette les bases de la future Entente Cordiale de 1904 dont il sera l’artisan, tout comme il sera l’artisan du rapprochement franco-russe.
3. La rivalité russo-japonaise
Puissance européenne, la Russie poursuit son expansion territoriale dans deux directions : me sud et l’est.
Vers la Méditerranée, elle se heurte à l’empire ottoman en plein déclin et aux puissances occidentales, Grande-Bretagne en tête et France, qui veut rejouer un rôle sur la scène européenne : défait lors de la guerre de Crimée (1856), Alexandre II renonce provisoirement au débouché méditerranéen, mais un nouveau conflit avec la Sublime Porte en 1878 lui permet de retrouver un accès au Danube, de parachever la conquête du Caucase et de prendre pied dans les Balkans par la création de la Bulgarie et l’indépendance de la Serbie et de la Roumanie… Il provoque du coup l’hostilité de l’empire austro-hongrois et de l’Angleterre…
Vers l’Orient, la Russie vise un accès à la mer du Japon. La Chine des Qing connaissant une période d’affaiblissement, les Russes commencent à coloniser le bassin de l’Amour au début du XIXè siècle, obtenant par divers traités le contrôle d'une façade maritime en mer libre sur l'océan Pacifique et de l’île de Sakhaline.

Le cuirassé Alexandre III à Kronstadt en 1904. Il sera coulé le 27 mai 1905 lors de la bataille de Tsushima. Des 782 marins, seuls 4 survivront. La quasi totalité de la flotte russe (21 navires de guerre) sera perdue lors de cette bataille. Près de 4 400 marins russes disparaissent.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
L’effondrement de la dynastie Qing (Guerre de Taiping, guerre contre la France, guerre des Boxers…) attise une course de vitesse entre l’empire russe et de l’empire du Japon pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Grâce à la réalisation du Transsibérien jusqu’à Vladivostok, les Russes prennent dans un premier temps l’avantage. En 1894, les Japonais, qui ont besoin de matières premières et de débouchés, occupent Séoul, provoquant l’entrée en guerre contre la Chine. Battus, les Chinois cèdent aux Japonais le contrôle de la Corée ainsi que Port Arthur, territoire chinois au sud de la Mandchourie. Mécontents, les Russes obtiennent la rétrocession de Port Arthur par Tokyo, sous la pression des toutes les puissances alors présentes en Chine. Elle en profite pour obtenir le protectorat sur la Mandchourie, construit le « Transmandchourien » d'Irkoutsk à Vladivostok et augmente sensiblement sa présence en Corée. En avril 1903, contrairement aux accords signés entre Saint-Pétersbourg et Péking, la Russie refuse d’évacuer ses troupes de Mandchourie. Tokyo décide d’intervenir militairement.
Beaucoup mieux préparée, disposant d’un armement moderne et d’une marine puissante, l’armée japonaise écrase l’armée Russe sur terre et sur mer (Bataille de Tsushima, 25-27 mai 1905), révélant les faiblesses de l’empire russe et accélérant la décomposition du régime.
4. La crise marocaine
a) 1905-1906 : Tanger et Algésiras
Entre l’Allemagne et la France, les tensions à propos de la question coloniale se tendent dans les premières années du XXè siècle, particulièrement au sujet du Maroc. Installée en Algérie depuis 1830, la France lorgne sur le Maroc, qui, à l’instar de la Turquie est « l’homme malade » de l’Afrique à la fin du XIXè. Dès 1880, la conférence de Madrid permet aux pays européens la liberté de posséder des terres et des biens dans tous les coins du pays : Espagne, France, Grande Bretagne et Allemagne espèrent ainsi préparer la voie à la conquête totale du pays. Rapidement, la France prend un avantage certain sur les autres et affirme son intention d’étendre son protectorat sur tout le Maroc. En 1901, suite à l’assassinat d’un commerçant oranais au Maroc, Théophile Delcassé, ministre des affaires étrangères, impose au sultan Abd al-Aziz (1878-1943) un accord autorisant la France à « aider » l'administration marocaine au « maintien de l'ordre » dans les régions incontrôlées du Maroc oriental. Le gouverneur général de l'Algérie, Charles Jonnart ordonne au colonel Lyautey, responsable militaire du sud-oranais, de « pacifier » la frontière algéro-marocaine. Lyautey pénètre régulièrement au Maroc et lance de longues reconnaissances atteignant le bassin de la Moulouya.
Au même moment est signée l’Entent Cordiale avec la Grande Bretagne, qui, en échange de l’abandon par la France de ses visées égyptiennes, lui laisse le champ libre au Maroc et à l’Espagne le nord (Ceuta) et l’extrême sud du Maroc. Delcassé pense avoir réglé la question marocaine. Il presse le sultan d’accepter l’aide de conseillers militaires et financiers afin de rétablir l’ordre et d’entreprendre la modernisation du pays.
Le sultan Abd al-Aziz, se doutant bien que l’indépendance de son pays est en jeu et ne pouvant plus compter sur le soutien anglais, se tourne vers l’Allemagne. Guillaume II et le chancelier von Bülow, extrêmement contrariés par le rapprochement franco-anglais, décident d’intervenir, d’autant qu’un sérieux incident maritime au Dogger-Bank entre la marine russe en route vers le Japon et une flottille anglaise leur laisse entrevoir un rapprochement avec Saint-Pétersbourg. Le 31 mars 1905, Guillaume II débarque théâtralement à Tanger, traverse la ville à cheval suivi d'un imposant cortège, et rencontre le sultan pour l’assurer de son appui et lui faire part de son désaccord face aux droits concédés à la France sur le Maroc. Abd el-Aziz, impressionné par ce discours, décide de refuser toutes les réformes précédemment conseillées par la France.
Ce discours de Tanger est immédiatement monté en épingle par la presse, autant en Allemagne qu’en France où il déchaîne une vague de revanchisme et de germanophobie. L’affaire prend de telles proportions qu’on prête au Kaiser l’intention d’entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines.

El-Hadj el-Mokri, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, signe le traité de la conférence d’Algésiras en présence des négociateurs, le 7 avril 1906. Document d’origine inconnue.
Photo. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
A l’Etat-major français, l’éventualité d’un conflit paraît beaucoup trop précoce : l’armée n’est pas prête. Aussi le président du conseil Maurice Rouvier décide de négocier : l’Allemagne obtient la démission de Delcassé, mais accepte le principe d’une conférence internationale… Cette conférence se tient du 16 janvier au 7 avril 1906 à Algésiras et réunit 12 pays européens et le Maroc sous la médiation du président Roosevelt. La conférence confirme l’indépendance de principe du Maroc, rappelle le droit d'accès de toutes les entreprises occidentales à son marché mais dans les faits elle établit des droits particuliers de la France et de l’Espagne sur le royaume chérifien : Paris et Madrid se voient confier le contrôle des ports, la France obtenant la présidence de la Banque d’Etat… C’est un échec pour le Reich, qui se sent de plus en plus isolé dans le concert des nations, d’autant que les liens entre la France et la Russie se resserrent …
Pour Berlin, l’affaire du Maroc n’est pas terminée, loin de là…
b) 1911 : le coup d’Agadir
Après Algésiras, la France accentue sa pression sur le sultan : en mars 1907, Lyautey occupe Oujda suite à un incident et début août, le général Drude occupe Casablanca et la région du Chaouia après des émeutes. Nouvel incident en septembre 1908 lorsque la police française arrête à Casablanca des soldats de la Légion étrangère que les agents consulaires allemands avaient aidé à déserter… En février 1909, France et Allemagne concluent un accord les associant dans toutes les entreprises marocaines qui tomberaient entre leurs mains.
Le 4 janvier 1908, le sultan Moulay Abd-ul-Aziz est renversé par son frère Moulay Hafid, opposé au traité d’Algésiras. Mais en 1911 Moulay est lui-même contesté par des tribus berbères du Moyen-Atlas qui l’assiègent dans Fès. Hafid appelle alors à son secours l’armée française, qui ne se fait pas prier : à la tête de 32 000 hommes, le général Charles Moinier libère Fès le 21 mai puis occupe les villes impériales de Rabat et Meknès.
L'Allemagne voit dans cette intervention une violation des accords d’Algésiras, mais décide d’agir unilatéralement, sans consulter les autres pays, ce qui accroît les malentendus. Le 1er juillet 1911, prétextant un appel à l’aide de commerçants allemands de la firme Mannesmann, elle envoie la canonnière SMS Panther bientôt relayée par le croiseur SMS Berlin et la canonnière SMS Eber dans la baie d’Agadir pour signifier à la France qu'elle n'a pas tous les droits au Maroc.
Immédiatement, l'opinion se déchaîne en France contre l'Allemagne. Les diplomates et l'état-major se montrent prêts à l'affrontement. À Londres, une bonne partie du gouvernement prend fait et cause pour Paris, craignant que l’Allemagne ne veuille établir à Agadir une base de sa Hochseeflotte pouvant menacer la route maritime des Indes, au moment même où la rivalité maritime entre les deux puissances bat son plein. Le gouvernement français, soutenu par son opinion, manifeste une très grande fermeté et n'exclut pas une réponse militaire. A Berlin, on est surpris par les vives réactions que provoque le coup de force et par les menaces de guerre. La crise provoque une panique financière à Berlin, les placements financiers français y étant très importants… L’Allemagne ne voulait d’ailleurs à ce moment-là aucune guerre.
De son côté le gouvernement de Joseph Caillaux, conscient qu'une guerre entraînerait la ruine de l'Europe, joue l’apaisement, résiste à toutes les pressions et amorce des négociations secrètes avec le chancelier Bethmann-Hollweg. Après d’âpres discussions menées par Caillaux lui-même assisté de l’ambassadeur Jules Cambon et Alfred von Kiderlen-Waechter, est signé un traité franco-allemand, le 4 novembre 1911 : l'Allemagne concède à la France une entière liberté d'action au Maroc en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km2 de territoires d'Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen-Congo, en Oubangui-Chari au profit du Cameroun allemand. Les navires allemands quittent définitivement la baie d'Agadir, le 28 novembre 1911. Le 30 mars 1912, la convention de Fès fait du Maroc un protectorat français. Le général Lyautey devient résident général, c’est-à-dire gouverneur du Maroc.
Mais ce traité n’est accepté ni en France ni en Allemagne : l’opinion considère dans les deux pays que leur gouvernement respectif à reculé et que le traité est une lâche concession à l'ennemi. Caillaux sera poussé à la démission le 11 janvier 1912, victime d’une campagne haineuse. Il sera même arrêté le 18 janvier 1918 sur ordre de Clémenceau et accusé de haute trahison.
Conclusion
L’impérialisme des grandes puissances et la compétition coloniale entre 1800 et 1911 auront comme effet principal de cristalliser les antagonismes entre nations, mais aussi de renforcer le jeu des alliances au gré des intérêts de chacun, en créant peu à peu les conditions d’un affrontement général.
Le bras-de-fer franco-allemand à propos du Maroc est révélateur de l’évolution de la situation européenne à la veille du conflit :
• il permet à la France d'éprouver son alliance avec la Grande-Bretagne et accentue l'hostilité de l'Allemagne à l'égard du Royaume-Uni.
• Il isole l’Allemagne qui se sent cernée d’ennemis de plus en plus belliqueux et d’une France toujours considérée comme l’ennemi principal, mais qui désormais n’est plus seule.
• Il convainc les puissances européennes de sa politique agressive et belliqueuse, de sa volonté de domination et de son impérialisme, même si le Kaiser et le chancelier jouent en fin de compte à chaque fois l’apaisement.
• La diplomatie allemande est battue en brèche : en intimidant ou en menaçant plusieurs pays de guerre en l'espace de quelques années, sans être capable de formuler un objectif réfléchi, l'Allemagne intensifie les peurs à son égard et fait émerger une coalition contre elle, sans gain substantiel en retour, sans consolider sa propre coalition. L’image du Kaiser devient celle d’un va-t’en-guerre impénitent. Il ne s’en remettra jamais.
• De son côté, et pour la première fois depuis la défaite de 1870, la France parvient à s'opposer avec succès à l'Allemagne qui occupe toujours l'Alsace-Lorraine. Le thème belliqueux de la « Revanche » et de la récupération des « Provinces perdues » revient avec force, à grand renfort de propagande.
• Dans le Reich, le gouvernement et le Kaiser passent pour des lâches, la presse nationaliste dénonce le fait que l'Allemagne ait risqué une guerre pour des « étangs congolais » et convainc de plus en plus de politiciens et de militaires de la nécessité d’une guerre « préventive » contre la France.
« L'accord conclu le 4 novembre 1911 sur le Maroc et le Congo ne contenta ni l'Allemagne, ni la France. Si chez nous, il a provoqué de la désillusion sur nos gains territoriaux en Afrique, au double point de vue de leur exiguïté et de leur valeur, en France, il y eut de la mauvaise humeur provenant de la dignité froissée. On ne pouvait se faire à l'idée de céder des terrains coloniaux acquis grâce à l'initiative et à l'esprit d'entreprise français, et cela sous une pression qui n'avait rien de glorieux (...) Le nouvel accord (...) laissait subsister un état d'énervement qui suscita de nombreuses difficultés (...) »
Von Schoen, Mémoires, Plon. Le baron Wilhelm Eduard von Schoen (1851-1933) est secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de l'empire allemand.
II Causes économiques : les crises du capitalisme
1. Le système capitaliste, générateur de tensions
La « Belle époque » est marquée par le développement rapide de l’économie capitaliste qui envahit peu à peu toutes les terres de la planète par la colonisation. Or le capitalisme, dans sa tendance naturelle à la concurrence, à la concentration et à la supra-nationalité, laisse très peu de place à l’équilibre des nations. Chaque pays cherche à être plus puissant militairement, plus compétitif économiquement, plus apte à maîtriser les sources d’énergie et matières premières que son voisin.
A la fin du XIXè siècle, les enjeux économiques, les rivalités commerciales, financières et industrielles accélèrent le déclenchement du conflit. L’arrivée en force de l’Allemagne dans la compétition internationale à partir du règne de Guillaume II, mais aussi des Etats-Unis et du Japon, bouleverse l’équilibre mondial : entre 1890 et 1914 la croissance allemande est spectaculaire : sa population passe de 49 millions à 66 millions, sa production de charbon triple, et celle d’acier est supérieure en 1914 à celle de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie réunies… Economiquement puissante, l’Allemagne investit chez ses voisins, Autriche-Hongrie, Roumanie (monopole commercial du pétrole roumain), France, Empire russe (concessions minières)… Ainsi, le Reich peut prétendre à une politique expansionniste et coloniale de premier plan, ce qui génère de graves tensions et l’exacerbation des sentiments nationaux. On est aux antipodes de la prudence et de la mesure bismarckienne.
Avec en 1910 la seconde flotte commerciale du monde, avec les accords passés avec la Turquie pour la construction du « Bagdadbahn » et son prolongement vers Mossoul, Berlin menace directement les intérêts de Londres, qui, implanté au Koweit depuis 1899, vise les immenses champs pétrolifères de Mésopotamie… Le capitalisme agressif allemand réussit au début du siècle à gagner partout de nouvelles parts de marché sur les cinq continents, menaçant même les Etats-Unis dans leur « pré carré » d’Amérique du Sud où le Japon en Chine.
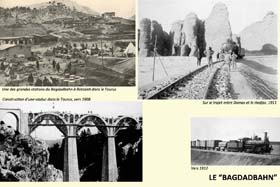
La construction du fameux Bagdadbahn marque une étape décisive dans la collaboration entre Berlin et Constantinople, qui entraînera fin 1914 l'entrée en guerre de la Turquie aux côtés des Empires Centraux.
Montage. Montage Georges Brun., 2015
La situation se tend encore après la défaite bulgare lors de la seconde guerre balkanique en 1913, qui est aussi une défaite germanique : l’Allemagne a en effet massivement investi dans les Balkans, en Turquie, Grèce, Roumanie, Bulgarie en prêtant des sommes considérables à ces pays ; mais rapidement elle manque d’argent et se voit supplantée par la France, premier investisseur mondial, qui en décembre 1913 devient le principal bailleur de fonds de la Grèce et de la Roumanie, puis de la Turquie où l’influence allemande décline en dépit du soutien résolu de l'état-major turc, enfin de l’Italie, que cette politique d’octroi de prêts financiers par la France détache peu à peu de la Triple Alliance.
2. La guerre, fruit du capitalisme ?
Pour de nombreux historiens de tendance socialiste ou marxiste, la guerre est une conséquence logique du système capitaliste, provoquée et voulue par la classe dirigeante, mue par des intérêts économiques et soucieuse de mâter un prolétariat qui n’en finit pas de relever la tête et de mettre ainsi un terme à la montée dangereuse (pour les capitalistes) du mouvement ouvrier.
Ce choix d’une « bonne guerre » pour rassembler la « nation » autour de son « Chef » a sans aucun doute joué au sein des milieux aristocratiques et grand-bourgeois proches du pouvoir, en particulier à Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg : la Russie est secouée en juin et juillet 1914 par des grèves générales massives, y compris dans la capitale Saint-Pétersbourg ; à Berlin l’aristocratie militaire, spécialement les grands propriétaires que sont les Junkers, qui par ailleurs fournissent l’essentiel des cadres de l’armée, est terrorisée par la perspective de l’arrivée au pouvoir des socialistes dont l’influence est croissante… Pour ces « élites », imprégnées de darwinisme social, la « masse », gagnée aux idées de révolution et de progrès, est dangereuse, et pour endiguer ce danger, la guerre constitue une solution permettant de substituer aux idées révolutionnaires celles de nation, de patrie, mais aussi d’ordre, de discipline, d’obéissance.
3. Les socialistes et la guerre
Au début du XXè siècle, tous les mouvements socialistes européens sont farouchement opposés à la guerre. Ainsi le dirigeant socialiste Jean Jaurès est convaincu que « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage », et bien des socialistes, aussi bien en France qu’en Allemagne, pensent que la guerre est le résultat d’un complot organisé par des capitalistes : l’expansion impérialiste des nations capitalistes est fondée sur la conquête coloniale de territoires, sur un rapport de force militaire, commercial et financier permanent pour gagner marchés et matières premières. Ils insistent tous sur la responsabilité des antagonismes impérialistes dans l’engrenage qui va mener au déclenchement de la guerre. Ils luttent tous pour prévenir des conséquences catastrophiques d’un tel conflit général.
« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente... »
Jean Jaurès (1859-1914).
Pour les marxistes, le capitalisme, c’est la guerre voulue par les grands patrons et les financiers afin de maintenir leur pouvoir sur le prolétariat et dominer le monde.
« Le développement des forces productives du capitalisme mondial a fait, au cours des dernières décennies, un bond gigantesque. Partout, dans le processus de lutte pour la concurrence, la grande production est sortie victorieuse, en groupant les « magnats du capital » en une organisation de fer qui a étendu son emprise sur la totalité de la vie économique. Une oligarchie financière s'est installée au pouvoir et dirige la production liée par les banques en un seul faisceau. Ce processus d'organisation de la production est parti d'en bas pour se consolider dans les cadres des États modernes devenus les interprètes fidèles des intérêts du capital financier. (...) La surproduction de marchandises inhérente au développement des grandes entreprises, la politique d'exportation des cartels et le rétrécissement des débouchés par suite de la politique coloniale et douanière des puissances capitalistes,... l'immense extension de l'exportation du capital et l'assujettissement économique de pays entiers à des consortiums bancaires nationaux portent au paroxysme l'antagonisme entre les intérêts des groupes nationaux du capital. Ces groupes puisent leur dernier argument dans la force et dans la puissance de l'organisation d'État et, en premier lieu, de leur flotte et de leurs armées. Un puissant État militaire est le dernier atout dans la lutte des puissances. »
Nikolaï Boukharine (1888-1938), l'économie mondiale et l'impérialisme, 1917. Éd. Anthropos, 1971. Boukharine est un penseur révolutionnaire et militant marxiste, compagnon de Lénine, membre du Comité Central du Parti communiste soviétique, éliminé par Staline en 1938.
Cette vision socialiste et marxiste d’une guerre voulue délibérément par les grandes puissances sous la pression des grands groupes industriels doit pour le moins être nuancée :
• Même si les grands industriels ont largement profité du conflit pour faire de confortables bénéfices (Krupp, Schneider, l’industrie américaine en général), l’immense majorité des entrepreneurs et des « capitalistes » sont pour la paix, la guerre étant généralement très mauvaise pour les affaires ;
• L’argument selon lequel la guerre mettrait fin aux revendications ouvrières et à l’agitation du prolétariat ne tient pas : en 1914, les mouvements ouvriers révolutionnaires sont très peu influents, voire inexistants ;
• Si dans leur ensemble les socialistes européens, avec comme chef de file le SPD allemand, condamnent la guerre au nom de l’internationalisme, s'ils votent contre les budgets militaires proposés par les gouvernements, ils ne parviennent cependant pas à mettre en oeuvre les moyens pratiques pour empêcher le déclenchement de la guerre. Ils restent divisés sur la manière de réagir en cas d’attaque de leur pays… Dans les faits, à la déclaration de guerre, les partis socialistes des divers pays belligérants se rallient rapidement à la guerre : c’est le cas en France avec l’Union Sacrée (3 août 1914) et en Allemagne avec le "Burgfrieden" ;
• Seuls les révolutionnaires marxistes russes et allemands (Lénine, Liebknecht, Luxemburg) s’en tiennent à leur théorie du capitalisme générateur de guerre : encore ne sont-ils pas au pouvoir au moment de la déclaration de guerre.
III Le jeu des alliances
1. Le système bismarckien : 1871 - 1890

Le système bismarckien.
Affiches. Montage Georges Brun à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
À l’issue de la guerre de 1870, Bismarck, conscient de la faiblesse du jeune empire, se fixe, en matière de politique européenne, le maintien de la paix et donc l’isolement de la France afin de lui ôter toute velléité de revanche et de reconquête de l'Alsace-Moselle. Il est convaincu qu'une réconciliation avec la France est impossible et qu'il doit faire face à une adversité durable avec son voisin de l'ouest. Conscient par ailleurs que l’Allemagne sera rapidement une grande puissance militaire et économique, il travaille à un nouvel équilibre en Europe en mettant en œuvre une politique extérieure particulièrement modérée, qui contraste avec l’autoritarisme de sa politique intérieure. Il lui faut créer une situation dans laquelle toutes les puissances auraient besoin de l'Allemagne et décide d'instaurer de bonnes relations avec les autres pays, hormis la France. Il élabore ainsi un système d’alliances, la « Bündnispolitik » pour échapper au « cauchemar des coalitions » et à un conflit sur deux fronts (« Zwei Frontenkrieg ») qu’il redoute particulièrement.
Dans un premier temps, il parvient à maintenir la France totalement isolée (1871-1890), mais son renvoi sonnera le glas de sa politique d’équilibre européen que le Kaiser, mais aussi la France s’ingénieront à ruiner en quelques années.
a) L'entente des trois empereurs
Le « Dreikaiserabkommen » (accord des trois empereurs) est le premier système bismarckien, élaboré en 1873 : afin de maintenir de bonnes relations avec l’empire russe et de se réconcilier avec Vienne, le chancelier tente de les unir sur des intérêts communs comme la lutte contre la montée du socialismes ou la solidarité des systèmes monarchiques… Mais cette alliance est sérieusement remise en cause lors de la crise dite « Krieg-in-Sicht » (guerre en vue) où il apparaît clairement qu’en cas de conflit entre l’Allemagne et la France, l'Angleterre et la Russie pencheraient du coté de Paris… L’accord des trois empereurs ne se maintiendra pas au-delà de 1878.
b) Le congrès des Nations de Berlin

Le congrès de Berlin de 1878 marque sans doute l'apogée de la diplomatie de Bismarck que Le Jeune Kaiser Guillaume II s'évertuera à démolir.
Montage. Montage Georges Brun d'après un document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
D’avril 1877 à janvier 1878 la Russie est en guerre contre la Turquie. Elle l’emporte et impose à la Sublime Porte le traité de San-Stefano (3 mars 1878) qui marque, par la reconnaissance de l’indépendances de plusieurs état balkaniques (Serbie, Bulgarie, Bosnie…), l’entrée en force de la Russie dans les Balkans. Ce traité déplait fort à la Grande Bretagne et à l’Autriche-Hongrie qui en demandent la révision. A Berlin, (13 juin–13 juillet 1878) Bismarck parvient à ménager à la fois Russes, Autrichiens, Turcs et Anglais, démontrant son rôle diplomatique central en Europe, et maintenant la France dans l’isolement. Mais ce sera au prix de la « balkanisation », de la fragmentation de cette région qui contribuera au déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Russie reste profondément déçue de l’attitude trop bienveillante de Bismarck vis-à-vis de l’Autriche-Hongrie, de l’Angleterre et de la Turquie.
c) La Duplice
La Duplice ou « Zweibund » lie en 1879 l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne : c’est un accord tacite défensif dirigé contre la Russie et son éventuel allié, la France, assurant un soutien mutuel dans le cas d'une attaque russe. L'Alliance oblige l'Autriche-Hongrie à rompre toute relation diplomatique amicale avec la France.
d) Le traité des trois empereurs
Deux ans plus tard, en 1881, Bismarck met en place un nouveau traité entre les trois empereurs : c’est le « Dreikaiserbündnis » alliant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie dans un pacte de « bienveillante neutralité » en cas d'une guerre. Il permet au chancelier de parer un conflit sur deux fronts en cas de guerre avec la France, mais ne résout en rien la rivalité entre la Russie et l'Autriche. Le pacte sera renouvelé en 1884 pour 3 ans, mais ne sera pas reconduit.
e) La Triplice
Créée le 20 mai 1882, la Triplice, ou « Dreibund » est un élargissement de la la Duplice à l'Italie. Les trois pays s'assurent une protection et une aide réciproque dans le cas d'une attaque française, l’Italie étant mécontente de la politique française visant à l’évincer de Tunisie. Le royaume de Roumanie y est secrètement associé par un traité signé le 30 octobre 1883, malgré l'existence en Transylvanie austro-hongroise d'une importante minorité roumaine. Ce pacte est renouvelé plusieurs fois jusqu’en 1914.
« Les hautes parties contractantes se promettent mutuellement paix et amitié, et n'entreront dans aucune alliance ou engagement dirigé contre un de leurs Etats. Elles s'engagent à procéder à un échange de vues sur les questions économiques et politiques de nature générale qui pourraient se poser et elles promettent, en autre, de s'aider mutuellement à l'intérieur des limites de leur propre intérêt. Au cas où l'Italie, sans provocation directe de sa part, serait attaquée par la France pour une raison quelconque, les deux parties contractantes s'engagent à porter assistance de toutes leurs forces à la partie attaquée... Si l'une ou l'autre des parties contractantes était attaquée sans provocation directe de sa part, ou engagée dans une guerre avec deux ou plusieurs grandes puissances non signataires du présent traité, le cas d'assistance surviendrait simultanément pour toutes les hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes promettent mutuellement de conserver secret le contenu et l'existence de ce traité... »
(Extraits de la Triplice, 1882).
f) Le traité de réassurance
En 1887, le traité de réassurance ou « Rückversicherungsvertrag » unit à nouveau l'Allemagne à la Russie impériale, après de longues négociations, car l’Autriche et la Russie restent opposées : Allemagne et Russie s’engagent à rester neutres en cas d’agression autrichienne contre la Russie et de la France contre l’Allemagne, qui par ailleurs s’engage à soutenir le tsar dans la question des Balkans et des Détroits.
Ainsi la « Realpolitik » de Bismarck vise essentiellement à protéger l'Allemagne géographiquement, à renforcer la puissance du pays et à disposer d’un maximum d'options en évitant de se retrouver isolé, mais tout en restant en retrait pour être le dernier pays à s'engager. Il veut se prévenir d’une alliance franco-russe dévastatrice pour son pays, éviter un conflit d’intérêt entre l’Autriche-Hongrie et la Russie, et combattre l'affaiblissement de la légitimité conservatrice dont ces trois puissances sont les dernières représentantes. Favorable au système mis en place par Metternich en 1815, il considère que l’État républicain français issu de la Révolution est dangereux pour le maintien de la paix en Europe, d’autant que la France réagit sur le plan militaire en réarmant rapidement.
2. Le bouleversement des alliances après Bismarck : 1890-1914

Caricature du journal anglais Punch de 1890 montrant le bouleversements occasionnés par le nouvelle politique de l'inconstant Guillaume II. Il tente de maintenir l'équilibre qu'ils s'est acharné à bouleverser. Assis dans le canot, la Russie (Alexandre III, l'Autriche-Hongrie (François-Joseph), la France (Marianne), l'Angleterre (Victoria tenant son petit fils).
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
L'empereur Guillaume Ier soutient le Reichskanzler jusqu'à la fin de son règne. L'arrivée au pouvoir de son petit-fils Guillaume II change totalement la donne : le nouvel empereur entend gouverner personnellement, entreprend des réformes libérales au sein du Reich et entend mener une politique extérieure donnant à l’Allemagne sa vraie place, c’est à dire la première. En total désaccord, le vieux chancelier « quitte le navire » (« Der Lotse geht von Bord», « Lao-Tseu quitte le navire») le 18 mars 1890 et est remplacé par le comte Leo von Caprivi (1833-1899). Rapidement, le système bismarckien d’équilibre d’alliances se trouve totalement bouleversé.
La politique expansionniste, « Weltpolitik » de Guillaume II, qui tend par ailleurs à fournir un dérivatif aux tensions internes d’un pays aspirant à une véritable démocratie, ne parvient qu'à exacerber la méfiance des puissances coloniales et commerciales déjà installées, et à cimenter des alliances dirigées contre le Reich : antagonismes pour la possession d'îles dans l'océan Pacifique et le contrôle de régions sur la route des Indes, tentatives allemandes de pénétration économique et politique dans l'Empire ottoman (Bagdadbahn, demande de concessions pétrolières en Mésopotamie), question marocaine...
Parallèlement sont mises en œuvre une politique de renforcement militaire (loi de 1890) et une politique de construction d’une puissante flotte de guerre afin de concurrencer la Grande-Bretagne.
a) L’évolution de la Triplice
Au sein de la Triplice, l’Autriche exprime quelques réticences vis-à-vis de l’Italie, à cause de sa politique coloniale en Afrique du nord (Lybie), réalisée aux dépens de l’empire ottoman, ce qui pourrait pousser encore un peu plus la Russie à intervenir dans les Balkans, et à cause de la question toujours épineuse des terres irrédentes du Trentin - Haut-Adige. Caprivi s’engage plus fortement envers l’Italie en la soutenant dans sa politique coloniale et en signant le 6 mai 1891 un traité d’assistance économique avec l’Italie et l’Autriche-Hongrie, avec la perspective d’y associer ultérieurement la Grande-Bretagne.
La Triplice, ou Triple Alliance est renouvelée en 1896, avec toujours comme objectif d’isoler la France, d’entraver son expansion coloniale (que Bismarck avait en son temps encouragée comme dérivatif à la « revanche ») et de rompre le rapprochement franco-russe, initié dès 1891. L’Italie se montre cependant de plus en plus réticente : l’affaire du télégramme Krüger a fortement indisposé la Grande-Bretagne, que l’Italie considère comme un pays ami, car concurrent de la France en Afrique. L’Italie entend désormais ne plus participer à une guerre offensive.

Caricature représentant la triplice. A gauche, Guillaume II empereur d'Allemagne ; au centre, Francesco Crispi, président du Conseil des ministres de l'Italie ; à droite, François-Joseph Ier empereur d'Autriche-Hongrie.
.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Effectivement, l’alliance italienne n’est pas fiable : la rivalité entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie dans les Balkans et sur la frontière austro-italienne est trop importante. Sur le plan économique, l’Italie a besoin d’investissements français, et les banquiers de Paris ne se font pas prier : en 1900 puis en 1902, des accords secrets franco-italiens annulent de fait les accords signés par Rome dans le cadre de la Triple Alliance. Si l’Italie signe en 1910 le renouvellement de la Triplice avec quelques nouvelles clauses l’engageant en cas de conflit (fourniture d'unités importantes, coopération navale austro-italienne dans l'Adriatique et en Méditerranée), Rome s’est presque totalement détachée de l'alliance germano-autrichienne et le royaume mène une politique de rapprochement avec la Russie et la France, au point que certains militaires de la double monarchie envisagent le déclenchement d'une guerre préventive contre cet allié peu sûr.
Afin de compléter et de renforcer leur alliance, l’Allemagne et l’Autriche cherchent de nouveaux partenaires : non sans arrière-pensées vis-à-vis de son « brillant second », le Reich entend mener sa propre politique dans les Balkans, en renforçant ses liens avec la Roumanie (pacte de 1883), avec la Grèce et surtout avec l'Empire ottoman, par des liens économiques et des conventions militaires (construction du Bagdadbahn, réorganisation des armées ottomanes, nomination de Liman von Sanders au poste d'instructeur général de l'armée ottomane, missions militaires). De son côté, Vienne se rapproche de la Bulgarie qui devient son fidèle allié face aux revendications du troublion serbe…
Ces alliances sont cependant fragilisées :
• elles renforcent le rapprochement franco-russe et anglo-russe…
• au début du XXè siècle, la Turquie et la Roumanie s’éloignent de la sphère d’influence germanique, car elles ont d’énormes besoins financiers auxquels la France est prête à répondre.
• la défaite bulgare contre la Serbie et la Grèce lors de la seconde guerre des Balkans (1913) incite les petits états balkaniques, par ailleurs gagnés au panslavisme, à se rapprocher de la Russie.
En 1913, devant la perte d'influence générale du Reich en Europe, le gouvernement et les militaires allemands sont amenés à soutenir totalement et aveuglement leur allié autrichien dans sa politique balkanique, d’autant que Vienne commence à se tourner vers la France, ayant besoin de capitaux que Paris peut lui fournir... le Kaiser est obligé de s'aligner totalement sur la politique de son entreprenant allié, alignement encore renforcé par l'alliance de revers franco-russe. Pour l'historien allemand Fritz Fischer, c'est dans ce contexte d'effritement de ses alliances que le Reich incite son allié austro-hongrois à se montrer ferme lors de la crise de juillet 1914.
3. La Triple-Entente
a) La Convention franco-russe
Totalement isolée par la politique de Bismarck, la France s’active à partir de 1890 à nouer son propre réseau d’alliances, bien aidée en cela, à son corps défendant, par les maladresses et l’orgueil de Guillaume II. Se efforts portent essentiellement vers la Russie et vers l’Angleterre, et sont principalement l’œuvre du président Sadi Carnot (1887-1894) et de Théophile Delcassé, ministre des affaires étrangères entre 1898 et 1905.
Désirant se rapprocher de l’empereur d’Autriche, Guillaume II ne renouvelle pas en 1890 le traité de réassurance avec la Russie et met fin à l’alliance des trois empereurs. Conscient que les positions de l’Autriche-Hongrie et de la Russie au sujet des Balkans sont inconciliables, inquiet des visées expansionnistes autrichiennes et désireux de s’ouvrir un accès sur la Méditerranée par les Détroits, le tsar Alexandre III (1845-1881-1894) dépêche immédiatement son ministre Nicolas de Giers (1820-1895) à Paris, visite ostensiblement en mai 1890 une exposition d’industriels français à Moscou et convie en août aux manœuvres militaires russes le général de Boisdeffre pour faire pièce au Kaiser qui s’y était invité de son propre chef. En outre, la Russie souhaite bénéficier des capitaux français, et dès 1888, un emprunt russe est émis à Paris, qui rencontre un immense succès et dont une grande partie finance les travaux du Transsibérien. D’autres gestes d’amitié suivent (décoration du président Carnot, commande à la manufacture d'armes de Châtellerault de 500 000 fusils « Mossine » (dérivés du Lebel), visite d’une escadre française à Cronstadt en juillet 1891, visite d’une escadre russe à Toulon en octobre 1893).
Le 17 août 1892 le général Raoul de Boisdeffre et le général Obroutcheff signent une première convention défensive prévoyant une mobilisation mutuelle des deux pays en cas de mobilisation d'une des puissances de la Triplice, une intervention russe contre l'Allemagne si l'Allemagne ou l'Italie (soutenue par l'Allemagne) attaquait la France et une intervention française contre l'Allemagne si celle-ci ou l'Autriche-Hongrie (soutenue par Berlin) attaquait la Russie. En cas de conflit, les Français engageraient immédiatement 1 300 000 hommes, les Russes 800 000, de manière que l'Allemagne ait à lutter à la fois à l'est et à l'ouest.
Le tsar ratifie la convention le 27 décembre 1893, le gouvernement français le 4 janvier 1894, malgré le scepticisme des Anglais.
b) L'amitié franco-russe
En 1896, le jeune empereur Nicolas II (1868-1894-1918) et son épouse Alexandra effectuent en voyage officiel en France : il pose le 7 octobre la première pierre du pont Alexandre III pour symboliser l'amitié franco-russe. L'année suivante le président Félix Faure se rend en visite officielle à Saint-Pétersbourg et pose la première pierre du Pont de la Trinité sur la Neva en l'honneur de l'alliance.
En août 1899, Théophile Delcassé négocie un renforcement de l'Alliance franco-russe : la France soutiendra la Russie dans sa politique balkanique si celle-ci en fait de même dans la question d'Alsace-Lorraine. En septembre 1901, Nicolas II revient en France et assiste à d’énormes manœuvres militaires (120 000 hommes !). La coopération financière s’accentue : en 1901, plus d’un tiers de l'épargne des ménages français se trouve investi dans l’économie russe ! En mai 1902, c’est le président Émile Loubet qui se rend en Russie.
c) L’Entente Cordiale

L'Entente cordiale vue par le patriotisme français et l'humour anglais.
Affiche. Montage à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
L’alliance russe acquise, il faut gagner celle de la Grande-Bretagne, l’ennemi historique. C’est curieusement l’incident de Fachoda qui en fournit l’occasion : ce que l’opinion française prend pour une reculade est en fait un compromis proposé par Delcassé, sur les conseils de Paul Cambon (1843-1924) et Léon Geoffray (1852-1927), chevilles ouvrières de l’Entente : il abandonne l'Egypte et l’Afrique orientale au Royaume-Uni, qui en échange lui laisse les mains libres au Maroc convoité par l'Allemagne. De plus, Paris fait comprendre à Londres que la « Weltpolitik » de Guillaume II est une terrible menace pour le commerce britannique et sa maîtrise des mers.
Le 8 avril 1904 marque l’acte de naissance de l’Entente Cordiale : France et Grande-Bretagne signent une série d’accords bilatéraux portant sur les droits de pêche français au large de Terre-Neuve, la légitimité anglaise sur l’Egypte, le protectorat français sur le Maroc et les sphères respectives d’influence des deux puissances au Siam, à Madagascar, aux Nouvelles-Hébrides.
d) Naissance de la Triple Entente
De leur côté, Royaume-Uni et Russie entament des négociations pour mettre un terme à leurs querelles, portant principalement sur leurs zones d’influence communes, la Perse et l’Afghanistan. Ils mettent de même un terme à leurs litiges maritimes (Affaire du Dogger Bank).
Le 31 août 1907 Londres et Saint-Pétersbourg signent un accord d’entente et de soutien mutuel. Ainsi naît la Triple-Entente, dont les engagements mutuels restent cependant inégaux : si l’alliance franco-russe est un accord militaire défensif, le Royaume-Uni se contente d'une promesse de soutien diplomatique en cas de conflit européen. Mais lors de la crise de juillet 1914, malgré ses efforts colossaux pour éviter la guerre, Londres s’engagera finalement dans le conflit : le prétexte en sera l’invasion de la Belgique par l'armée allemande.
La création de cette alliance « de revers » est très mal vécue dans le Reich et y créé un profond sentiment d’encerclement : ainsi se renforce le théorie de la « guerre préventive ». Par contre elle ne modère en rien la politique impérialiste qu'entend mener Guillaume II.
4. Le renforcement des alliances : 1907-1914
A partir de 1907, et surtout de 1911, les risques de guerre semblent inéluctables aux dirigeants européens : la logique des systèmes d'alliances accélère la course aux armements et renforce les partenariats, alors que et des deux côtés les diplomaties s’activent à faire entrer dans le jeu d’autres pays, plus ou moins déjà partenaires :
• France et Royaume-Uni déploient leurs efforts vis-à-vis de l’Italie afin de la détacher de la Triple Alliance : ils laissent à l’Italie libre cours en Tripolitaine. Rome restera neutre au début du conflit avant de basculer dans le camp de l’Entente le 3 mai 1915 en rompant le pacte de la Triplice et en déclarant la guerre à l’Autriche-Hongrie le 23 du même mois.
• En 1912, France et Royaume-Uni signent une convention navale qui répartit leurs zones de défense en cas de conflit : à la « Royale » est confiée la Méditerranée, tandis que la « Navy » défendra la mer du Nord et la Manche./p>
• La Russie, remise en selle depuis la guerre balkanique de 1913 mène une politique très active contre l’Autriche-Hongrie en apportant un soutien sans faille à la petite Serbie, elle-même extrêmement agressive dans sa politique panslave dirigée contre la double monarchie et l’empire ottoman.
• La France de son côté s’évertue à créer un axe Paris-Belgrade, axe renforcé par la visite du roi Pierre de Serbie (1844-1903-1921) à Paris en novembre 1911.
• La Turquie enfin resserre ses liens avec l’Allemagne : conséquence de la débâcle des guerres balkaniques et de l’humiliation libyenne (La Lybie est prise par l’Italie en 1912), la Sublime Porte est en 1913 profondément isolée. Les intentions russes sont alors extrêmement claires : « le ministre affirme que la Russie ne peut permettre à aucune puissance de s’affermir dans les Détroits ; elle peut par la suite être forcée de s’en emparer pour y établir un état des choses conforme à ses intérêts » (Conférence de Saint-Pétersbourg du 8 février 1914 réunissant Serguei Sazonoff, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine, le chef d’Etat-major général et Mikhaïl de Giers, ambassadeur à Constantinople). Le Bosphore et les Dardanelles, « clefs de la maison » (Catherine II) demeurent le point central de la stratégie russe (80% de la production de la Russie y transitent). Quant aux Anglais, ils tiennent à protéger la route des Indes transitant par le canal de Suez. L’Italie, installée dans le Dodécanèse, lorgne du côté de l’Asie Mineure, alors que la France veut faire valoir ses droits sur la Cilicie. Au pouvoir depuis janvier 1913, les Jeunes Turcs d’Enver Pacha n’ont que le choix de se tourner vers Berlin, convaincus que le danger russe est bien plus grand que le danger autrichien, et que la Turquie est engagée dans une lutte à mort dont l’enjeu est sa survie, et qui, accessoirement, démasquerait la duplicité des populations chrétiennes (Arméniens). D’abord réticent à cause de la situation catastrophique de la Turquie et son impréparation, Guillaume II finit par pencher pour une alliance avec la Sublime Porte. Le 2 novembre 1914, la Turquie entrera en guerre au sein de la Triplice.

Le rapprochement Berlin - Vienne - Constantinople. Affiche de propagande des années 1910, auteur inconnu.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2010

La visite du roi Pierre Ier de Serbie en France en 1911. Couverture du supplément illustré du Petit Journal, 26 novembre 1911.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
IV Les nationalismes
1. La montée des nationalismes au XIXème
La compétition patriotique générée par l'émergence des nationalismes au cours du XIXème siècle explique pour beaucoup le déclenchement de la guerre en 1914. « Chaque peuple paraît à travers les rues de l’Europe avec sa torche et maintenant voilà l’incendie ». (Jean Jaurès, discours de Vaise, 25 juillet 1914)
« En ces dernières heures du siècle, je voudrais méditer sur l’une des forces qui ont été à la fois les plus créatrices et les plus dissolvantes ... le nationalisme... Certes, les tendances nationales ont aussi servi la culture... Mais ces avantages pèsent moins lourd que les inconvénients qui en ont résulté et qui ont fait du nationalisme le facteur politique dominant. La haine de tout ce qui est étranger... transforme rapidement le sentiment national en un instinct qui échappe au contrôle de la raison... Le nationalisme, en se combinant avec d’autres forces, nous conduit irrésistiblement vers de nouvelles catastrophes. »
Harold Hjarne, journal Svenska Dagblade, 31 décembre 1899. Hjarne (1848-1922) était un historien suédois, professeur à l’université d’Uppsala.
Le XIXè voit surgir un phénomène, capital, né des bouleversements du XVIè siècle et surtout de la Révolution française : le nationalisme. Cette idée n'est pas fondée sur la souveraineté d'un monarque sur une ou plusieurs populations, mais sur l'existence d'une culture sociale, historique et linguistique commune à une population donnée. Ainsi, la nation est la volonté de tout un peuple d’affirmer son identité, sa spécificité, d’exister librement.
Au XIXème, la notion de « nation » se base généralement sur :
• Le désir de s’unir et de vivre en commun ;
• le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
• le sentiment d’appartenance à une communauté historique, ethnique et culturelle ;
• la nécessité de constituer un marché économique indépendant ou élargi.
a) L’œuvre de la Révolution française
La Révolution française et les guerres napoléoniennes ont remodelé l'Europe du XVIIIe siècle. Par ses conquêtes, Napoléon exporte auprès des populations les idées de 1789. Le Code civil français est souvent adopté par les pays conquis où il reste la base de la législation, même après la défaite française : les principes de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen sont amplement diffusés, particulièrement le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont la notion de nationalité est le corollaire.
En 1815, le Congrès de Vienne renforce cependant les régimes autocratiques et autoritaires, faisant fi de l’acquis révolutionnaire. Véritable « Yalta » avant l'heure, il fait la part belle à l’empire austro-hongrois qui « aspire » les peuples d’Europe centrale, de la Pologne aux Balkans et s’intéresse de très près à l’empire ottoman, le « Vieil homme malade », et à l’empire russe où les tsars tentent d’étendre leur domination en Finlande, Pologne, Baltique et lorgnent eux aussi vers les Balkans et les populations slaves avec le but à long terme de s’accaparer les Détroits… Quant à la Grande-Bretagne, elle se désintéresse du continent dans un « Splendide isolement », mais veille jalousement sur son empire commercial et maritime. Ainsi au nom du nouvel « équilibre » de Metternich, le principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et remisé aux oubliettes.
b) L'émergence des sentiments nationaux
Les idées semées par la Révolution font cependant leur chemin et le principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes aboutit au long du siècle à deux phénomènes : les conquêtes de l’indépendance politique et la constitution d’états autour d’une culture commune :
• Les conquêtes de l’indépendance : l’aspiration à l’indépendance des peuples se manifeste d’abord en Amérique du Sud, où le continent se libère de la tutelle espagnole et portugaise (Simon Bolivar, 1825), mais éclate en une multiplicité de petites nations toutes jalouses de leur indépendance et dominées par une élite autocratique qui maintiennent les populations pauvres et les minorités dans une totale dépendance… En Europe, la Belgique se détache des Pays-Bas et dans les Balkans encore contrôlés par la Turquie, les Grecs livrent une dure guerre d’indépendance (1821-1830), suivis à la fin du siècle par la Serbie, le Monténégro, la Roumanie, la Bulgarie. En 1848, c’est toute l’Europe qui est secouée par des mouvements révolutionnaires au nom du principe de l’autodétermination des peuples et de la démocratie. Sévèrement réprimé, le « printemps des peuples » se double, particulièrement en Autriche-Hongrie, de la question des nationalités : il aboutit partiellement : en 1867 est proclamée à Vienne la double monarchie, laissant à la Hongrie une assez large autonomie. Mais il ne résout pas la question de plus en plus brûlante des autres minorités.
• La constitution d’états : par ailleurs, des États se constituent au nom d'une culture et d'une « Nation » commune : c'est notamment le cas de l'Allemagne avec la création de l'Empire allemand en 1871 ou de l'Italie, dont l'unification est réalisée en 1870. Dès le début du XIXè, la question « nationalitaire » imprègne les élites et la sphère culturelle dans l’espace italien et dans l’espace germanique et consolide les populations concernées dans une idée de culture nationale basée notamment sur la langue et bientôt, plus spécifiquement dans l’ère germanique, sur la notion de race.
À l'aube du XXe siècle, la question des nationalités en Europe reste au cœur des tensions. L'Autriche-Hongrie et la Russie souhaitent voir leur influence se développer sur les territoires des « Slaves du Sud », la Pologne aspire à son indépendance vis-à-vis de la Russie, la Norvège souhaite se libérer de la Suède, la Hongrie de l'Autriche.
Pour autant, la question des nationalités en Europe ne concerne que les territoires du vieux continent et son prolongement américain. Avec un autre principe posé en absolu dans la seconde moitié du XIXè, celui de la supériorité de l’homme blanc, il n'est pas question de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les populations du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye...), d'Afrique noire ou d'Asie. Pour ces populations, le XIXe siècle n'est pas celui du printemps des peuples mais le siècle de la dernière vague de colonisation.
c) La montée en puissance des sentiments nationaux

Carte de l’Autriche-Hongrie en 1911. Les diverses minorités, toutes travaillées par un nationalisme souvent très vindicatif, mettent en lumière la grande fragilité de cet immense empire dont les dirigeants ne sont plus capables d’assurer la cohésion.
Carte. Georges Brun., 2015
Dans l'ensemble de ces jeunes et nouveaux pays européens, la force des nationalismes crée les conditions de l'exaltation de sentiments nationaux et du développement des rivalités nationales, darwinisme social aidant. Ainsi, après le départ de Bismarck, les responsables du Reich, Guillaume II en tête, formulent les rivalités politiques et économiques avec leurs voisins de l’Est comme la manifestation du conflit entre les Slaves et les Germains. Multipliant les allusions à un conflit multiséculaire germano-slave, l'empereur allemand inspire certains de ses collaborateurs, dont son chef d'état-major, Helmuth von Moltke, et développe devant des représentants austro-hongrois des arguments de même nature.
Face à ce sentiment de l'existence d'une opposition entre les Germains et les Slaves, les populations slaves en général et russes en particulier développent en leur sein un sentiment panslave, encouragé par le gouvernement après les défaites de 1904-1905.
Pour ne pas être en reste, dans l’empire ottoman en pleine décrépitude, le mouvement Jeune Turc qui accède au pouvoir en 1913 développe des théories panturques, seules capables de redresser et der sauver la Sublime Porte.
d) Le rôle du darwinisme social
Toutes ces théories, tant celle de la supériorité de l’Homme européen et de sa « mission » civilisatrice, que celle du nationalisme basé sur des supériorités culturelles et raciales, se basent sur les théories darwiniennes transposées sur le plan social (Herbert Spencer, 1820-1903), alors fort en vogue dans toute l’Europe : selon le darwinisme social, la guerre est bonne en soi car créatrice d’un ordre hiérarchisé, voué à inculquer aux masses les vertus de l’obéissance et du devoir accompli ; elle fait surgir au grand jour les hommes doués, transforme les asservis en hommes libres, jette à bas les vieilles idoles.
À la fin du XIXe siècle, le darwinisme social est étendu aux rapports entre les nations : il justifie ainsi en Angleterre et en France le colonialisme par la « supériorité de l’homme blanc et sa mission civilisatrice », et en Allemagne la supériorité du germain sur le slave. Ces théories portent en elles de terribles germes : ceux de l’éliminationnisme et du génocide.
2. L’impérialisme anglais
Après la défaite de la France napoléonienne en 1815, la Grande-Bretagne connaît un siècle de domination sans partage et étend ses possessions dans le monde entier. Entre 1815 et 1914, environ 26 000 000 km2 de territoires et environ 400 millions de personnes sont intégrés dans l'Empire. Dominant les mers, le Royaume-Uni devient le gendarme imposant la « Pax Britannica » et une politique étrangère de « splendide isolement », investissant toute son énergie dans le commerce mondial, ce qui lui permet de contrôler les économies de nombreux pays comme la Chine, l'Argentine ou le Siam.

Walter Crane (1845-1915) : carte de l'empire britannique en 1886, avec en rouge les possessions de la couronne.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
La puissance impériale britannique est soutenue par la plus grande flotte de commerce et de guerre du monde ainsi que par le télégraphe, deux technologies qui permettent à la Grande-Bretagne de contrôler et de défendre son empire.
« Une nation est comme un individu : elle a ses devoirs à remplir et nous ne pouvons plus déserter nos devoirs envers tant de peuples remis à notre tutelle. C'est notre domination qui, seule, peut assurer la paix. La sécurité et la richesse à tant de malheureux qui jamais auparavant ne connurent ces bienfaits. C'est en achevant cette œuvre civilisatrice que nous remplirons notre mission nationale, pour l'éternel profit des peuples à l'ombre de notre sceptre impérial (...) Cette unité (de l'Empire) nous est commandée par l'intérêt : le premier devoir de nos hommes d'Etat est d'établir à jamais cette union sur la base des intérêts matériels (...) Oui, je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues, en cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue que nul climat, nul changement ne peuvent abâtardir et qui infailliblement sera la force prédominante de la future histoire et de la civilisation universelle (...) et je crois en l'avenir de cet Empire, large comme le monde, dont un Anglais ne peut parler sans un frisson d'enthousiasme (...) »
Joseph Chamberlain (1836-1914), ministre des colonies en 1895.
3. Le nationalisme français
L’idée que la France est une nation « une et indivisible », nait à la fin du XVIIIe siècle sous la plume des philosophes des Lumières. Elle connaît son apogée à la Révolution française, notamment lors de la fête de la Fédération. Ce nationalisme connaît en France un développement spécifique après 1870, à l'avènement de la IIIè République. À cette époque tous les partis manifestent ostensiblement des idées nationalistes et antiallemandes : la Prusse vient de gagner une guerre et d’annexer l'Alsace-Lorraine.
Aussi la IIIè république met l’accent à la fois sur l’unité de la nation (mêmes lois, mêmes règlements, même langue, même culture pour un ensemble de populations différentes) pour développer le « sentiment d'être français » (Renan) et sur la « reconquêtes des provinces perdues ». La République développe ainsi le sentiment national de 1870 à 1914 en créant ou en réactivant des mythes historiques, tels les figures de Vercingétorix, Clovis ou Jeanne d’Arc et des références souvent « spirituelles » ou morales, voire xénophobes.
Cependant, lors de la crise boulangiste et de l'affaire Dreyfus, le nationalisme glisse progressivement à droite et devient, dans les années 1880, une revendication d’exclusivisme et se teinte de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme (Edouard Drumont, "La France juive", 1886), d’antiparlementarisme et d’anti-républicanisme (la « Gueuse », la République), ne cessant de dénoncer « quatre États confédérés : Juif, Protestant, Maçon, Métèque » (Charles Maurras). Le cosmopolitisme, si cher aux philosophes des Lumières, devient synonyme de menace pour la cohésion de la nation, étant rattaché en particulier aux juifs : « le Juif cosmopolite est, par nature, ennemi des patries ».

En France, le nationalisme outrancier se teinte très souvent d'antisémitisme : caricature de Henri Meyer pour la couverture du supplément illustré du Petit Journal, 10 juillet 1898, a propos de l'affaire Dreyfus. Bibliothèque nationale de France. Y figurent notamment Jacques Cavaignac, sous-secrétaire d'État à la Guerre, Jules Méline, Paul Déroulède et Etienne Drumont, anti-dreyfusards violents.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Naissent alors les mouvement de droite et d’extrême droite qui marquent, selon l’expression de Michel Winock, le passage du « nationalisme ouvert » au « nationalisme fermé » : "Ligue des patriotes" de Paul Déroulède (1882), "Union patriotique de France" (1888), "Ligue de la patrie française" (1898), "Action Française" (1898) … Les thèmes de ces mouvements d’extrême droite sont alors assez clairs et partagés par nombre de personnalités de premier plan comme Déroulède, Barrès, Coppée, Degas, d’Indy, Maurras… : pour reconquérir les territoires perdus, pour préparer la revanche contre la Prusse, il faut sortir le pays de la décadence et créer une nouvelle France. Cette dernière doit mettre en place une société disciplinée, régie par un pouvoir autoritaire et organisée sur le modèle militaire (avec respect de la hiérarchie et culte du sacrifice).
Parallèlement, dans l’opinion publique, se développe le « Revanchisme », commun à la droite et la gauche : il s’agit de prendre sa revanche sur la Prusse, de fixer son regard sur la « ligne bleue des Vosges » afin de récupérer l’Alsace-Lorraine. Pour les militants revanchards, il s’agit de maintenir l’animosité contre l’ennemi allemand et de rechercher le casus belli. Pour l’opinion française, travaillée par la presse et les lobbys nationalistes, les Alsaciens-Lorrains sont soumis depuis 1871 à un régime oppressif et elle entretient la nostalgie des provinces perdues. Ce sentiment est ainsi illustré, par le succès du livre « Le Tour de France par deux enfants » (Augustine Fouillée alias G. Bruno, 1877), ou par la célèbre réponse à Mommsen de Fustel de Coulanges (voir infra). Ce revanchisme fait partie des programmes pédagogiques de l’école de la IIIè République : il s’agit de transmettre aux génération de futurs poilus la prise de conscience que la perte de l’Alsace-Lorraine constitue une atteinte à l’intégrité territoriale de la patrie. De plus, la République encourage de nombreuses initiatives privées, qui, entre 1870 et 1914, inondent la France de monuments aux morts commémorant la guerre de 1870, de multiples fêtes de « la revanche » célébrant les vétérans et les régiments.

Quelques figures du nationalisme français des années. 1880-1914. Il est important de faire la différence entre un nationalisme violemment antisémite et xénophobe (Drumont) et un nationalisme plus proche du patriotisme (Barrès).
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Toutefois, l’échec du boulangisme, la conquête coloniale et le progrès matériel font passer le revanchisme au second plan à partir des années 1880 : la puissance économique et militaire allemande aidant, ainsi d’ailleurs que son agressivité, un autre thème nationaliste surgit et devient de plus en plus important : celui de la « défense de la patrie » : pour les Français de 1914, il s’agit plus de se défendre en cas d'agression allemande que de « prendre sa revanche », même si le thème du revanchisme revient en force dans l’opinion aux premières heures de la guerre.
« C’est donc seulement à la toute fin du 19e siècle qu’une nouvelle doctrine politique s’installe dans le paysage idéologique, certes sous le nom de "nationalisme", mais dissimulant derrière cette désignation vague une étrange tentative de synthèse entre une vision traditionaliste de l’ordre social, une version scientiste de la "théorie des races" et une conception conspirationniste de l’ennemi (Juifs, francs-maçons, etc.), dont dérive l’appel xénophobe à défendre par tous les moyens la nation française menacée, la « vieille France » (Drumont), la « France des Français » (Soury). »
Pierre-André Taguieff (Né en 1946) sociologue, politologue et historien des idées. Théories du nationalisme. Nation, Nationalité, Ethnicité, Paris, Kimé, « Histoire des idées, théorie politique et recherches en sciences sociales », 1991.
« Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Oh ! Je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l'ordre d'idées que je vous soumets, une nation n'a plus le droit de dire à une province : « Tu m'appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu'un en cette affaire a le droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours revenir. (...)
Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889) : réponse à Theodor Mommsen, qui avait publié Agli Italiani. Revue des deux Mondes. 27 octobre 1870.
4. Le nationalisme allemand et le pangermanisme

Carte postale publiée en 1914, caricaturant l'impérialisme pangermaniste du Kaiser Guillaume II.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Le nationalisme allemand est d’un autre type que le français. Pour réaliser son unité sur les ruines du Saint-Empire-Romain-Germanique, l’Allemagne mène trois guerres successives, et le poids politique de l’armée et de l’orgueilleuse noblesse prussienne apparaît fondamental.
Le processus d’unification débute paradoxalement par la défaite des Prussiens à Iéna-Auerstedt en octobre 1806 contre Napoléon. L’élite prussienne en sort durablement traumatisée mais prend conscience, à l’instar de Carl von Clausewitz (1780-1831) ou de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), de la nécessité de faire de l’Allemagne un nation qui soit à l’égal de la France, cette dernière servant à la fois de modèle et de repoussoir à l’unité allemande : le nationalisme allemand est à la fois teinté de francophobie et nourri du libéralisme politique issu de la Révolution française.
Napoléon vaincu, la France réduite à ses frontières de 1789, la Prusse entame une formidable expansion qui s’accompagne d’un violent sentiment anti-français : la France devient l’« Erbfeind », l’ennemi héréditaire : la xénophobie, distillée par la littérature, la presse et l'historiographie allemande resserre l’identité nationale : la volonté de Bismarck d’unifier l’empire sous l’égide de la Prusse « par le fer et le sang » fera le reste. Curieusement, en France, on admire la Prusse, considérée depuis la Révolution comme un pays moderne, protestant, efficace et dynamique.
La politique bismarckienne est cependant plus prussienne que germanique. Bismarck n’entend en aucune façon faire de l’unité allemande un instrument hégémonique, bien au contraire : tous ses efforts tendent à maintenir sur le continent l’équilibre des puissances, même si cet équilibre est dirigé contre la France. Bismarck s'appuie de plus sur des alliances à l'Est qui lui interdisent toute velléité d'expansion en Europe centrale et orientale. Son système d’alliance garantit pendant vingt ans (1870-1890) la paix et l’équilibre politique en Europe.
Le nationalisme allemand se transforme radicalement après le départ du Chancelier de fer : la « Weltpolitik » du Kaiser, sa politique coloniale agressive et sa politique de concurrence maritime met le Reich en rivalité directe avec la France et l’Angleterre. Elle s’accompagne d’un regain de nationalisme très marqué par le darwinisme social mettant en avant le principe de l’inévitable affrontement entre les nations « jeunes » et viriles (Allemagne) et les nations « anciennes » et « décadentes » (France).
C’est ainsi qu’émerge en Allemagne dans les années 1890 un mouvement essentiellement bourgeois, constitué surtout d'anciens militaires (en partie en retraite...) et des strates supérieures de la bourgeoisie prussienne, la « Ligue Pangermanique » (Alldeutscher Verband) dont l’influence va grandissante au Parlement et dans les organismes étatiques. Cette ligue défend le « Volkstum », la nation en tant que race, et se base sur le principe de la supériorité de la race germanique : celle-ci doit avoir une position hégémonique eu Europe, grâce à une forte croissance démographique, preuve de sa vitalité, grâce à une grande puissance économique et si besoin, grâce à la guerre… Ainsi le darwinisme social rencontre le nationalisme racial. Regroupée derrière Heinrich Class (1868-1953), la « Ligue pangermaniste » organise sa propagande autour de la notion des « idées allemands dans le monde », contribuant à entretenir dans l'opinion publique du Reich un climat favorable à une politique impérialiste.

Germania. Allégorie de Friedrich August von Kaulbach. Huile sur toile, 1914. Deutsches Historisches Museum, Berlin.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
En 1905, Ernst Hasse (1846-1906), responsable de la ligue pangermaniste, définit l'expansion territoriale, européenne et extra-européenne, comme « nécessaire au développement d'un organisme vivant et sain ». La même année, Joseph-Ludwig Reimer, dans son ouvrage « Une Allemagne pangermaniste » met l’accent sur la supériorité raciale germanique vis-à-vis des peuples slaves et des autres nations occidentales, se désespère de la « dégermanisation » de la France que l’Allemagne devrait coloniser… en commençant par le nord et l’est ! En 1911, Otto Richard Tannenberg publie « Grossdeutschland » (Le rêve allemand, la plus grande Allemagne) qui rencontre un grand succès : il y développe des thèses pangermanistes extrêmement bellicistes, projetant de rassembler tous les allemands au sein d’un empire raciste : « Quelle situation pitoyable que la nôtre, si l'on considère que pas moins de 25 millions d'Allemands, c'est-à-dire 28% de la race, vivent au-delà des limites de l'empire allemand ! C'est là un chiffre colossal, et un fait pareil ne saurait se produire dans un autre État quelconque sans susciter la plus vive indignation de tous les citoyens et l'effort le plus passionné pour remédier au mal sans plus attendre. (...) Qui pourrait empêcher 87 millions d'hommes de former un empire, s'ils en faisaient le serment ? »
D’autres groupes de pression influents oeuvrent en faveur d'une politique étrangère active pour permettre au Reich d'accéder au statut de puissance mondiale. Ainsi le « Flottenverein » pousse le gouvernement à se lancer dans la création d’une flotte de guerre capable de rivaliser avec la Grand Fleet ; une autre ligue très influente, le « Wehrverein », la Ligue pour l'armement, est créée en 1912 afin de soutenir la campagne des armements.
Il ne faut certes pas trop exagérer l’influence des thèses nationalistes et pangermaniques dans le déclenchement de la guerre. Mais il ne fait pas de doute qu’après le départ de Bismarck, elles se sont répandues assez largement à la cour de Prusse et dans les cercles de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie militaire du Reich.
5. Le panslavisme
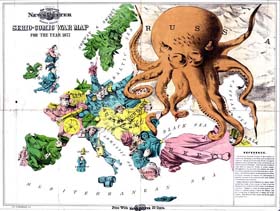
Affiche humoristique anglaise de 1877 "A comic map of Europe" montrant lma Russie sous les traits d'une pieuvre monstrueuse s'apprêtant à dévorer ses voisins, et plus particulièrement la Turquie. .
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
La sphère culturelle germanique n'est pas la seule à voir le succès des thèses unificatrices. Ainsi, la Russie encourage le développement de théories panslaves qui bénéficient dans l'empire russe d'un certain consensus.
Le panslavisme est une doctrine politique, culturelle et sociale qui valorise l'identité commune que partageraient les différents peuples slaves comme les Polonais, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Croates, Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Macédoniens, Bulgares, Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Ruthènes et qui préconise leur union politique sur la base de cette identité.
Le mouvement panslave atteint son essor avec le Congrès panslave de Prague qui se réunit le 2 juin 1848. Le 13 juin, les révolutionnaires tchèques se soulèvent à Prague contre la suprématie autrichienne. L'insurrection est écrasée le 17 juin 1848 mais le mouvement révolutionnaire gagne Vienne en octobre pour être immédiatement réprimé, puis la Hongrie où Kossuth déclare l’indépendance en avril 1849. Il faut aux Autrichiens l’aide des Russes de Nicolas I pour venir à bout de la Hongrie en août, permettant au tsar de prendre pied dans la région…
Le flambeau du panslavisme est repris dans les Balkans, où les Slaves, particulièrement en Serbie et en Bulgarie, luttent depuis des siècles contre la domination ottomane et germanique. En 1877-1878, la guerre russo-turque renforce énormément les liens entre les Slaves du Sud et la Russie : le situation internationale et le jeu des alliances feront le reste.
« Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité, Nous Pierre, Empereur et autocréateur de toute la Russie, déclarons à tous nos descendants et successeurs au trône et gouvernement de la nation russienne.(...)
8. S'étendre sans relâche vers le nord, le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire. (...)
10. Rechercher et entretenir avec soin l'alliance de l'Autriche; appuyer en apparence ses idées de royauté future sur l'Allemagne, et exciter contre elle, par-dessous main, la jalousie des princes. Tâcher de faire réclamer des secours de la Russie par les uns ou par les autres, et exercer sur le pays une espèce de protection qui prépare la domination future.
11. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe, et neutraliser ses jalousies lors de la conquête de Constantinople, soit en lui suscitant une guerre avec les anciens Etats de l'Europe, soit en lui donnant une portion de la conquête qu'on lui reprendra plus tard.
12. S'attacher à réunir autour de soi tous les Grecs désunis ou schismatiques qui sont répandus, soit dans la Hongrie, soit dans la Turquie, soit dans le midi de la Pologne; (...) ce seront autant d'amis qu'on aura chez chacun de ses ennemis. »
Extrait du testament de Pierre le Grand. (Copie remise par le chevalier d'Eon à Louis XV, en 1757)
« Le 19 mai 1891, à Vladivostok, l'héritier tsarévitch, actuellement empereur régnant, daigna charger lui-même une brouettée de terre et posa la première pierre du grand chemin de fer transsibérien. ... Toutes les mesures prises témoignent de la grande force du peuple grand-russien slave qui est destiné à servir de guide au christianisme et à la civilisation de l'Orient asiatique. »
Extrait d'un guide du chemin de fer transsibérien paru en 1900.
6. Le nationalisme italien
Le royaume d’Italie se fonde en 1861 sous l’influence de Guiseppe Mazzini (1802-1872) et le rôle décisif joué par Cavour (1810-1861), Garibaldi (1807-1882) ou Napoléon III. La Vénétie est acquise sur l’Autriche grâce à l’appui de l’Italie à la Prusse et la victoire de cette dernière à Sadowa (1866).
A la fin du siècle deux grands courants animent la vie politique italienne : l’irrédentisme et le nationalisme.
• l’irrédentisme est un mouvement né dans les années 1870-1880, dont l’objectif prioritaire est de récupérer les terres encore sous domination autrichienne : le Trentin - Haut-Adige, Trieste et l’Istrie. L’ennemi clairement désigné est l’Autriche, alors que la France, et même la Suisse, possèdent des terres « irrédentes » (Nice, Corse, Tessin…). Cela n’empêche pas l’Italie d’adhérer à la Triplice en 1882, en grande partie à cause du différend tunisien avec la France, et de renouveler l’engagement en 1887, contre des compensations autrichiennes en cas d’expansion dans les Balkans (article 7) et des aides militaires allemandes en cas de conflit avec la France à propos de l’Afrique du nord (article 9) : à partir de cette période, l’irrédentisme est mis en sommeil. Il revient à l’avant-plan lorsque l’Italie se détache peu à peu de la Triplice au début du XXè siècle.
• Le nationalisme italien change à la même période avec les mêmes thématiques impérialistes que les autres puissances coloniales : il faut à l’Italie, désormais grande nation, des terres à conquérir et des marchés à exploiter. L’Italie s’aventure en effet dans la conquête coloniale, sa terre de prédilection étant l’Afrique du Nord toute proche, plus précisément la Tunisie, la Lybie mais aussi l’Erythrée. En Tunisie, l’opposition active de la France se règle par l’accord du 28 septembre 1896 laissant pratiquement les mains libres à Paris. Dans la Corne de l’Afrique, après des débuts prometteurs (Erythrée 1822, Somalie 1887), Rome veut pousser son avantage et vise la conquête de l’Ethiopie. C’est compter sans l’opposition de la Grande-Bretagne, qui voit rouge dès que l’on s’approche du canal de Suez, et qui soutien la résistance du Négus Ménélik II : le 1 mars 1896, l’Italie subit une humiliante défaite à Adoua contre les troupes éthiopiennes armées par les Anglais.
• Le pays tente alors d’oublier sa frustration coloniale en mettant l’accent sur une nouvelle forme de « colonisation à l’italienne », celle d'une Italie « plus grande », fondée sur le travail de ses millions enfants émigrés dans le monde entier, principalement en Amérique (Argentine, Etats-Unis).
«Tout comme les Anglais disent qu'il n'y a pas qu'une Angleterre, mais une Angleterre plus grande (a greater England) formée par ses vastes colonies, nous pouvons dire qu'il n'y a pas qu'une Italie, mais une Italie plus grande, formée par son émigration répandue dans le monde, par groupes de milliers, de centaines de mille, de millions de travailleurs italiens. Par leur ténacité, par leur sobriété, par leur travail ininterrompu, ces fils du pays du doux farniente ont créé une nouvelle Italie en dehors de nos frontières».
Pasquale Villari (1827-1917), historien et home politique italien.
Ce rêve prend cependant fin lorsque la situation internationale se tend au début du XXè siècle : la politique agressive de l’Autriche dans les Balkans mais aussi dans les terres irrédentes contre tout ce qui est italien (refus de créer une université de langue italienne à Trente et Trieste) revigore l’irrédentisme qui, non content de ses revendications classiques, réaffirme ouvertement des velléités annexionnistes dans les Balkans (Dalmatie, Albanie) et la Tripolitaine. Ainsi irrédentisme et nationalisme expansionniste se mêlent dans une sorte de nostalgie de la Rome impériale qui s’inspire du « nationalisme charnel » de Barrès, mais aussi du nationalisme allemand de type pangermaniste. Le nationalisme italien devient alors un nationalisme de type conservateur, prônant une révolution conservatrice, l’exaltation de la guerre, voire le refus de la démocratie représentative, avec des accents de racisme. Les chantres de ce nationalisme sont Enrico Corradini (1865-1935), Giovanni Papini (1881-1956), Giuseppe Prezzolini (1862-1962), Gabriele d’Annunzio (1863-1838)

L’Italie, puissance coloniale : page de garde du supplément du « Petit Journal », 15 octobre 1911.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
« L’indépendance, c’est à dire la destruction des obstacles intérieurs et extérieurs qui s’opposent à la constitution de la vie nationale, doit donc s’obtenir non seulement pour le peuple, mais par le peuple. La guerre par tous, la victoire pour tous... Créer : créer un peuple ! Il est temps, ô jeunes gens, de comprendre combien est grande, religieuse et sainte l’œuvre que Dieu vous confie. Elle ne saurait s’accomplir... que par l’exemple vivant donné aux multitudes d’une vertu austère, par les sueurs de l’âme et les sacrifices du sang... par l’audace de la foi, par cet enthousiasme solennel, indomptable, inaltérable qui remplit le cœur de l’homme lorsqu’il ne reconnaît pour maître que Dieu..., pour unique but l’avenir de l’Italie ».
Giuseppe Mazzini, République et royauté en Italie. Giuseppe Mazzini (1805 – 1872) est un révolutionnaire et patriote italien, fervent républicain et combattant pour la réalisation de l'unité italienne.
7. Le panturquisme
Le panturquisme ou turquisme est une idéologie nationaliste née au XIXe siècle cherchant à renforcer les liens entre tous les peuples turcophones musulmans, voire à susciter leur union au sein d'un même État. Ce concept naît chez les Tatars de Crimée et les populations turcophones d’Asie centrale, confrontés à la politique tsariste de russification et de christianisation de l’empire. Il est ensuite popularisé par le mouvement des Jeunes Turcs de l’empire Ottoman, rival et victime de la Russie, et plus particulièrement par Enver Pacha (1881-1922), qui soutient les turcs de Russie.

Principales personnalités du mouvement Jeune Jurc.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public. Parmi eux, Enver Pacha, Talaat Pacha, Djemal Pacha, Nazim Bey sont les grands responsables du massacre des Arméniens. , 2015
Ce nationalisme turc, inexistant avant le XIXè siècle dans l’empire ottoman, est nettement marqué par l’influence de l’Europe occidentale sur les minorités arméniennes ou grecques, les poussant à des revendications nationalistes. Peu à peu naît l'idée que les Turcs ont eux aussi une identité nationale distincte au sein du monde musulman...
Dans le même temps se fait sentir dans l’empire ottoman l’influence des Orientalistes occidentaux qui ont fait découvrir les cultures arabes, nord-africaines et turques (Hugo, Flaubert, Delacroix…), précédant la naissance de la « turcologie », qui met en lumière le rôle des peuples turcs dans l'histoire eurasienne ainsi que leur histoire avant l'islam, héritage négligé et rejeté jusqu'alors par les Turcs entièrement tournés vers leur identité musulmane.
Ces idées nouvelles sont reprises par les élites turques : de nombreux jeunes turcs partent étudier en Europe et par ailleurs de nombreux Polonais et Hongrois se réfugient en Turquie après les révolutions réprimées de 1848, y important leurs idéaux nationalistes romantiques, certains allant même jusqu’à se convertir à l’islam.
En 1913, ces jeunes turcs, fortement influencés par les idées panturques, prennent le pouvoir dans l’Empire ottoman. La guerre qui éclate en 1914 contre la Russie se présente comme une occasion unique de prendre une revanche sur les Russes et peut être plus encore. Le rêve trouvera sa conclusion finale en 1922 avec la mort d’Enver Pacha, principal chef des Jeunes Turcs, alors qu’il menait une rébellion contre le pouvoir bolchevik en Asie centrale.
Un des aspects les plus noirs du panturquisme est son racisme et son exclusivisme : il aboutit au premier génocide du XXème siècle : celui des Arméniens.
V La course aux armements
En réponse à la montée des tensions internationales et à la confrontation des impérialismes coloniaux, particulièrement à partir de 1890, les nations européennes adoptent des politiques intérieures et extérieures qui accentuent à leur tour le risque d’embrasement. Persuadées que leurs intérêts sont menacés, elles entretiennent en temps de paix de puissantes armées permanentes, constamment modernisées et agrandies par des mesures de conscription. Loin d’ailleurs d'être un cas isolé, cette course aux armements concerne aussi d'autres pays émergeant comme grandes puissances, tels le Japon ou les États-Unis, et, dans une moindre mesure, certains pays d'Amérique du Sud.

Usine Krupp à Essen, dans la Ruhr : production de canons de gros calibre et de pièces d'artillerie de marine. Photo parue dans le The New York Times Current History of the European War, janvier-mars 1915.
Photo. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Par ailleurs, cette course aux armements s’explique aussi par l’évolution technologique provoquée par la révolution industrielle. Des technologies nouvelles apparaissent, accélérant l’adoption par les diverses armées d’armes nouvelles comme les fusils rayés à culasse, les explosifs, les mitrailleuses, mais aussi le chemin de fer, l’électricité, le moteur à explosion ou encore l’aviation… Chaque puissance prend grand soin de ne pas rester en retrait de ses rivales dans l’équipement de ses forces combattantes.
Il faut aussi noter le rôle et l’influence des militaires hauts gradés et des états-majors, particulièrement dans les empires allemand, austro-hongrois et russe, régimes bien plus militaristes, où l’aristocratie militaire (Les Junkers prussiens) est politiquement plus influente que les ministres civils : ainsi en Allemagne Von Moltke ou Tirpitz s’opposent systématiquement au chancelier Bethmann-Holwegg et jouent les va-t’en guerre lors de la crise de juillet 1914 ; Franz Conrad von Hötzendorf, chef d’état-major autrichien déteste les Serbes et veut absolument intervenir contre la Serbie, surtout après la seconde guerre balkanique, contre l’avis d’Istvan Tisza, président du conseil hongrois ; en Russie, après l’échec des réformes de Stolypine, le tsar gouverne en autocrate tout-puissant.

Tableau des dépenses en armement des grandes puissances entre 1900 et 1914.
Schéma. Document Georges Brun., 2015
La course aux armements menant à la grande déflagration connaît trois grandes phases :
• le réarmement français entre 1871 et 1895 ;
• la compétition navale et le réarmement russe : 1898-1912 ;
• l’accélération et la mise en place de plans de guerre : 1912-1914.
1. Phase I 1871 – 1895 : le réarmement français et le système Ser de Rivières
Au moment où les dernières troupes d'occupation allemandes quittent le pays en 1873, le gouvernement de la IIIè République créé le « Comité de Défense » (1872 - 1888). Son objectif est de réorganiser la défense de toutes les frontières du pays, notamment de boucher la brèche béante laissée par la perte des places fortes de l'Est (Strasbourg, Metz, Bitche…), de moderniser les anciennes places obsolètes et de créer des forts adaptés aux nouvelles techniques de combat, plus particulièrement l’artillerie.

Vue du fort de Douaumont. Photographie aérienne de1916, avant l'offensive allemande.Ce fort est l'un des plus célèbres du système Séré de Rivières.
Affiche. Document Commons Wikimedia, base Mérimée. Domaine public., 2015
Secrétaire du Comité, le général Séré de Rivières (1815-1895) est rapidement chargé de la réalisation de ce système qu’il théorise dans deux rapports : « Considérations sur la reconstruction de la frontière de l'Est » (21 juin 1873) et « Exposé sur le système défensif de la France » (20 mai 1874). Pour Séré de Rivières, il s’agit de « Créer sur la frontière qui s'étend de Calais à Nice, en arrière de cette frontière et jusqu'à Paris, un système défensif général en tenant compte des conditions de la guerre moderne, des effectifs mis en ligne, de l'importance des chemins de fer et des progrès de l'artillerie. »
Les travaux débutent rapidement, avant le vote du financement par l'Assemblée nationale le 17 juillet 1874 et vont s’accélérant, car de l’autre côté du Rhin, Bismarck, obsédé par le danger d’un nouveau conflit avec la France, songe en 1875 à une nouvelle intervention militaire.
Les travaux se poursuivent pratiquement jusqu’au début de la guerre sous la direction de Cosseron de Villenoisy après l’éviction et la mise à la retraite de Séré de Rivières en 1880. L’effort de fortification porte sur deux grands ensembles : la zone fortifiée de Verdun-Toul et celle d’Epinal-Belfort, séparées par des « trouées » (Oise, Stenay, Charmes, Belfort), elles-mêmes verrouillées par des forts de seconde zone : ainsi sortent de terre Vaux, Douaumont, Souville, Manonvilliers.
De valeur inégale (certains forts seront même désarmés car jugés obsolètes en 1914…) le système défensif de Séré des Rivières oblige les Allemands à trouver une parade : ce sera le fameux plan de contournement conçu par Alfred von Schlieffen.
Parallèlement, après le désastre de 1870, l’armée est profondément réformée… sur le modèle prussien. Les nouvelles grandes unités (corps d'armée, divisions, brigades) sont mises en place dès le temps de paix selon des circonscriptions territoriales prédéfinies, assurant une préparation plus satisfaisante des troupes : ainsi sont mis en place 19 corps d’armées et le gouvernorat de la place de Paris.

Le soldat d'infanterie français en 1914 est bien mieux préparé et équipé qu'en 1870. Malheureusement, son uniforme n'est pas du tout adapté, et surtout, le commandement de l'armée française est hélas "en retard d'une guerre".
Montage. Montage Georges Brun., 2015
Le sommet de la hiérarchie militaire s'articule au sein du Conseil Supérieur de la Guerre, placé sous la Présidence du ministre de la guerre et composé des généraux de division inspecteurs d'armée, du chef de l'état major général et du vice président du conseil supérieur de la guerre, chargé (à partir de 1890) du commandement suprême de la masse de manœuvre.
Le recrutement de l’armée est transformé par les lois Cissey (1872), Freycinet (1889), André (1905, suppression du tirage au sort) et Barthou (1913), cette dernière instaurant le service militaire obligatoire de trois ans.
Enfin de notables progrès techniques sont réalisés dans l’armement : l’armée se dote du fameux canon de 75 (1897), du fusil Lebel (1887) et des premières mitrailleuses. La mobilisation des troupes est efficace et les communications bien assurées grâce au réseau ferré.
Ainsi, en 1914, malgré ses faiblesses (manque d’artillerie lourde, cavalerie obsolète, équipement souvent désuet, carences du haut-commandement) l’armée française est incontestablement mieux préparée à un conflit qu’en 1870.
2. PHASE II 1898-1912 : La compétition navale, le Royaume-Uni et le « Two-power standard »
a) Introduction
En 1890, le Royaume-Uni dispose depuis près d’un siècle de la plus grande flotte marchande et militaire au monde. Le contrôle des mers est vital pour le pays : tout son approvisionnement, toutes ses exportations se font par voie maritime : une flotte puissante et omniprésente est indispensable à la cohésion et au maintien de son immense empire colonial.
Or la fin du siècle voit la montée en puissance de la concurrence de nations nouvelles (Allemagne, Etats-Unis, Japon…) ainsi que des innovations technologiques importantes dans le domaine naval, spécialement en ce qui concerne la marine de guerre : canons en tourelles, blindages en acier puis totalité du bâtiment en acier, tubes lance-torpilles…
Comme la France et la Russie améliorent à leur tour leurs marines de guerre, l’Angleterre adopte en 1889 le « British Naval Defense Act » dont le principe de base est le « Two-Power Standard » : la Royal Navy s’oblige à posséder une flotte de guerre égale ou supérieure aux deux marines de guerre étrangères les plus puissantes après elle, se garantissant ainsi une suprématie théoriquement constante sur ses rivales. Un tel principe à lui seul justifie amplement la course à l’armement naval et la Grande Bretagne fait des efforts constants pour maintenir sa suprématie face aux autres marines, et ce bien avant que l’Allemagne ne décide de se lancer dans la compétition. Ainsi, ce même Naval Defense Act de 1889 entraîne la construction de 8 nouveaux cuirassés face à la concurrence française et russe.
b) L’Allemagne entre dans le jeu
En Allemagne, après le renvoi de Bismarck, Guillaume II met en œuvre sa « Weltpolitik » devant faire du Reich une grande puissance mondiale. L'industrie allemande, en pleine expansion, doit trouver de nouvelles sources de matières premières et de nouveaux clients ; comme de plus le Reich possède quelques colonies, il doit protéger ses liaisons maritimes commerciales. La construction d'une flotte puissante fournit enfin des commandes et du travail à la métallurgie et aux chantiers navals allemands.
Secrétaire d'État de l'office du Reich à la Marine, le grand-amiral Alfred von Tirpitz (1849-1930) est chargé de la mise en œuvre du programme : il fixe comme objectif dans son mémorandum du 15 juin 1897 la construction d’une flotte de guerre dont la taille corresponde aux 2/3 de celle de la marine britannique et qui soit capable de « déployer son potentiel d’Helgoland à l’embouchure de la Tamise ». Ce mémorandum arrive à point, car il est une réponse à la menace britannique de mars de la même année de bloquer les côtes allemandes en cas d’intervention du Reich dans le conflit du Transvaal qui occupait alors Londres (Télégramme Krüger)…

La première et seconde escadre de la "Hochseeflotte", la marine de guerre allemande, accompagnées de croiseurs dans le port de Kiel, vers 1911.
Affiche. Document Commons Wikimedia. U.S. National Archives and Records Administration Domaine public., 2015
Dès l’année suivante, Tirpitz lance la construction d’une nouvelle Kriegsmarine (Hochseeflotte) avec la mise en chantier sur trois ans de 16 cuirassés. Uns seconde loi, votée le 20 juin 1900, double la flotte (de 18 à 38 navires) et lance véritablement la course, suite à l’arraisonnement par la Navy de trois paquebots allemands au large des côtes de l'Afrique du sud en janvier 1900, lors de la seconde guerre des Boers, les Anglais soupçonnant les Allemands d’aider les Boers. La loi prévoit la construction, entre 1901 et 1917, de deux vaisseaux-amiraux, de 32 cuirassés répartis en 4 escadres et de 4 cuirassés de réserve. La même loi désigne explicitement la Grande-Bretagne comme le principal adversaire naval.
Trois autres lois Tirpitz vont être votées, ponctuant à chaque fois un moment de tension internationale et facilitant ainsi leur adoption : en juin 1906, en réponse aux décisions de la conférence d’Algésiras défavorable au Reich, la Kriegsmarine se voit dotée de 6 nouveaux croiseurs de bataille. En avril 1908, suite à des déclarations du roi Edouard IV, Berlin est convaincu de la volonté de l’Entente d’encercler le Reich : un nouvelle loi prévoit le remplacement des navires vieux de plus de 25 ans ; enfin, en juin 1912, suite à la crise d’Agadir, une nouvelle loi ajoute 3 cuirassés au programme de construction.
c) La réponse britannique
Se sentant menacée par l’expansion de la marine allemande, le Royaume-Uni se rapproche de la France et de la Russie et développe entre 1902 et 1906 son propre programme d'expansion pour contrer les Allemands.
Sous la conduite de l’Amiral John Fisher (1841-1920), retenant les leçons de la guerre russo-japonaise, les Britanniques conçoivent deux nouveaux types de bâtiments de guerre : le croiseur de bataille (type HMS Invincible) dont la puissance de feu et le blindages sont moindres que ceux du cuirassé, mais dont la vitesse est largement supérieure, et surtout un nouveau cuirassé révolutionnaire, le HMS Dreadnought (1906) : vitesse de 21 nœuds grâce à des turbines à vapeur, artillerie principale de 8 pièces de 305mm en tourelles (au lieu de 4), tir de salves… Ce type de cuirassé surclasse tous les autres navires, mais est bientôt imité par les autres marines, ce qui ne fait que renforcer la course aux armements…

Construit en 1906, le HMS Dreadnought et le premier cuirassé moderne. Révolutionnaire par sa propulsion (turbines à vapeur) et son armement, il rend désuets tous les navires du guerre précendants et inaugure une féroce course aux armement entre la Royal Navy et la Kaiserliche Marine.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Entre 1906 et 1910, Les Britanniques construisent 6 cuirassés de type Dreadnought, puis, comme les Allemands relèvent le défi, 10 super-dreadnoughts entre 1912 et 1913, encore plus puissants (classes Queen Elizabeth et Revenge). Durant la même période, ils aménagent une énorme base navale à Scapa Flow, au nord de l’Ecosse.
En même temps, les rivaux tentent de négocier : en 1908 le Royaume Uni propose la limitation du tonnage des flottes respectives, avec le maintien de la supériorité britannique. L’Allemagne refuse. De nouvelles négociations sont engagées en 1912 : côté allemand, le chancelier Bethmann Hollweg cherche un accord avec les Britanniques pour mettre fin à l’isolement de l'Allemagne et veut ralentir, voire stopper la course aux armements navals : il sait que la Kriegsmarine ne pourra pas rattraper son retard sur la Navy et qu’il devient urgent de donner la priorité à l’armée de terre face à la menace croissante de l’armée russe ; côté britannique, les radicaux réclament la fin de l’escalade et le premier Lord de l'Amirauté, Winston Churchill est favorable à des « vacances navales » (naval holiday), conscient que la supériorité britannique est désormais définitivement assise et que les véritables besoins sont du côté de l’armée de terre.

U-Boote allemands dans le port de Kiel et février 1914 ; au premier plan les U-22, U-20, U-19 et U-21. Au second plan, les U-14, U-15, U-12, U-16, U-18, U-17, et U-13. Au fond, les U-11, U-9, U-6, U-7, U-8 et U-5.
Affiche. Document Commons Wikimedia. United States Library of Congress's. Domaine public., 2015
Aussi en février 1912 le ministre de la guerre Richard Haldane se rend à Berlin pour sonder les Allemands en vue d'un accord : les Allemands sont prêts à reconnaître la supériorité navale britannique, en échange d’une neutralité britannique en cas d’un conflit où l’Allemagne serait l’agressée. Clause inacceptable pour Londres, la supériorité navale anglaise étant un fait acquis et les Anglais n’ayant rien à y gagner. La mission Haldane s’achève donc sur un échec. Pour le Royaume-Uni il est désormais évident que seule une guerre permettra de stopper la menace allemande.
Ainsi, à la déclaration de guerre, même si le principe du « Two power standart » (L’amirauté avait même envisagé en 1908 un « Two power plus ten percent ») n’est plus de mise, la Royal Navy conserve une incontestable supériorité. Les Allemands ont renoncé à la supériorité sur mer, mais adoptent une nouvelle politique navale, qu’ils tiennent encore secrète : la construction de sous-marins, sous-marins qui s’avéreront une arme terriblement redoutable.
d) Les autres pays
Naturellement, les autres puissances européenne, pour ne par être en reste, se lancent à leur tour dans la course :
• L’Autriche-Hongrie lance la modernisation de sa flotte de guerre en 1909 avec un programme de construction de 4 cuirassés « Dreadnoughts » et 4 autres, plus petits. La flotte autrichienne, basée en Adriatique, dispose en 1914 de 15 cuirassés (dont 3 dreadnought), 13 croiseurs, 27 destroyers et 7 sous-marins.
• L’Italie répond en se lançant dans la construction de 5 cuirassés dreadnought (dont le Dante Alighieri). Elle dispose en 1914 de la 7ème flotte de guerre du monde avec 21 cuirassés, 27 croiseurs et 32 destroyers.
• La Russie, après l’humiliante défaite de Tsushima en 1905, lance en 1909 un programme de construction de 4 super-dreadnoughts pour sa flotte de la Baltique, afin de contrer la puissance de la Hochseeflotte du Reich : le premier est mis en mer lorsque Poincaré arrive en Russie en juillet 1914. Le pays ne parviendra cependant pas à rattraper son retard.
• Quant à la marine française, elle est au début du XXème obsolète et en cours de déclassement (c’est une « marine de prototypes »), même si en tonnage elle est encore en seconde position. La Royale se lance dans la course à la modernisation en 1904 suite à la signature de l’Entente cordiale, mais ne met en chantier les premiers dreadnoughts qu’à partir de 1910… Aussi, à l’entrée en guerre, sa marine de guerre est encore beaucoup trop vétuste… « Si on laisse de côté la force morale, la marine française n’est à présent guère plus que l’égale des forces austro-hongroises » (Times, 3 février 1914). La marine française aura un rôle marginal durant le conflit.
3. PHASE III L’accélération et la mise en place de plans de guerre : 1912-1914 :
Les diverses crises qui se succèdent à la fin du XIXè et au début du XXè (Fachoda, Agadir, Tanger …) ne sont pas en soi porteuses de guerre, car à chaque fois les négociations diplomatiques l’emportent. Elles ont cependant pour effet, d’autres facteurs aidant (compétition navale et économique), de faire monter les tensions et de raffermir la bipolarité des deux blocs européens : l’idée d’un conflit possible, voire inévitable, fait peu à peu son chemin, d’abord au sein des divers états-majors militaires, puis dans les esprits des politiques et enfin dans les populations, propagande aidant…

La première conférence de La Haye, juin 1899.Cette première Conférence de la Haye est due aux efforts du Tsar sur la thématique du désarmement mondial. Il espérait ainsi épargner à son pays un énorme fardeau financier afin de rattraper le retard de la Russie face à l'Allemagne et à l'Autriche. La Conférence sera à cet égard un échec. Elle codifiera par contre certaines règles de la guerre et créera un tribunal international d'arbitrage, qui aura une certaine influence sur le déroulement du conflit qui s’annonçait.
Photo. Document Commons Wikimedia. From the collections of the Imperial War Museums, UK. Domaine public., 2015
Au début du XXè siècle, aucune grande puissance ne veut la guerre, mais chacune s’y prépare : le temps est encore aux de négociations : pour enrayer la course aux armements au coût exorbitant, qui place les États dans une logique de guerre, les gouvernements tentent même de négocier un désarmement mondial : par deux fois, en mai 1899 et en juin 1907 les puissances se réunissent en conférence à la Haye.
Mais ces conférences (la première à l’initiative de Nicolas II, le seconde à celle du président Roosevelt), si elles mettent en place le principe du droit humanitaire international et celui du règlement pacifique des conflits internationaux par la création d’une instance permanente et d’un Bureau International, ne parviennent pas à instaurer un véritable climat de confiance et de paix entre les nations : le diverses mesures adoptées en cas de conflit armé (interdiction des bombardements aériens, des gaz asphyxiants, des balles explosives, des baïonnettes à dents de scie…) montrent bien que les gens se faisaient peu d’illusions quant à la probabilité d’un conflit généralisé. La question n’est déjà plus : « comment éviter la guerre ? » mais bien : « comment rendre la prochaine guerre la moins inhumaine possible ? »
La crise des Balkans et les deux guerres qui s’en suivent (8 octobre 1912 au 30 mai 1913 pour la première, 16 juin – 18 juillet 1913 pour la seconde) accélèrent incontestablement la course aux armements dans tous les pays : dans les esprits, la guerre est désormais inéluctable et chaque puissance fourbit ses armes : entre 1912 et 1914, les effectifs des armées, les tonnages des marines de guerre et les budgets militaires connaissent une croissance quasi exponentielle.
a) En Russie
Sévèrement battu en Extrême Orient, le Tsar se tourne en 1912 vers les Balkans et vise l’accès à la Méditerranée par le contrôle des Détroits, provoquant le crise des Balkans et préparant une intervention militaire : la Russie accélère alors ses préparatifs : les effectifs de l’armée russe en temps de paix sont portés de 1 300 000 à 1 800 000 hommes ; grâce à l’aide financière de la France, l’armée russe modernise son artillerie, créé de nouvelles lignes de chemin de fer vers les frontières allemande et autrichienne et améliore notablement la formation de ses officiers. Cette modernisation de l’armée est cependant très lente et programmée sur plusieurs années, ce qui rassure quelque peu l’Etat-major allemand. La Russie augmente son budget de plus 80% pour disposer de 1 834 millions de marks-or en 1912.
b) En Autriche-Hongrie
La double monarchie, sous la direction militaire de Franz Conrad von Hötzendorf (1852-1925), n’entend pas se laisser distancer par son principal adversaire russe : souhaitant donner à la monarchie des moyens militaires à la mesure de sa place au sein des puissances européennes, il obtient une hausse conséquente du budget militaire, porté à 250 millions de couronnes ; en 1912, la durée du service militaire est portée à 3 années et le contingent annuel de l'armée commune est porté de 103 000 à 160 000 hommes en temps de paix. À la fin de l'année 1913, une nouvelle loi militaire est proposée au vote du parlement. Elle ne permettra cependant pas à la double monarchie d'achever la remise en état de son appareil militaire.
c) Dans le Reich
En Allemagne, dès mars 1911, pour faire poids au réarmement russe, le Reich adopte, sur les pressions de son état-major, des dispositions visant à augmenter les effectifs en temps de paix et à former ces nouveaux soldats. Fin 1912, von Moltke obtient une augmentation massive de l'armée impériale en temps paix qui passe à 761 000 soldats, devant encore être renforcée de 60 000 soldats supplémentaires à l’horizon d'octobre 1914 (loi de juillet 1913). A cette augmentation des effectifs correspond une augmentation rapide des budgets du ministère de la guerre : L'Allemagne augmente de 250% son budget militaire entre 1905 et 1912 (il atteint alors plus de 3 244 millions de marks-or). Entre 1910 et 1914, les budgets militaires doublent, passant de 205 à 442 millions de dollars.
Enfin, les Allemands densifient leur réseau ferré sur la frontière française. Pour eux en effet, il est clair que la guerre se déroulera sur deux fronts, la Triple Entente voulant l’attaquer à la fois à l’est et à l’ouest : il leur faut donc une armée considérable, qui doit d’abord et très rapidement écraser l’armée française, la plus dangereuse car rapidement opérationnelle, avant de se tourner contre l’armée du tsar, dont la mobilisation est bien plus lente.
Devant le renforcement constant des capacités militaires des probables adversaires du Reich, les responsables militaires émettent à partir de 1912 l'idée d'une guerre préventive contre la France et la Russie avant que cette dernière ne soit trop forte, c’est-à-dire avant 1916-1917. Idée de guerre préventive dont d’ailleurs les responsables français et britanniques sont parfaitement conscients.
d) En France
En plus du redressement militaire amorcé dès les années 1875, la France entend répliquer aux dispositions allemandes votées en 1912-1912 et donc à renforcer encore son dispositif militaire. Joseph Joffre, nommé à la tête de l’armée française en juillet 1911, demande début 1913 le vote d'une nouvelle loi militaire, permettant un rééquilibrage du rapport de force franco-allemand : le 7 août 1913 le parlement français adopte la loi des trois ans qui porte la durée du service militaire de deux à trois ans et les effectifs de l’armée à 750 000 hommes.
Ces mesures sont assez mal acceptées par la population, particulièrement par le monde paysan, et combattues par les socialistes, mais une propagande savamment orchestrée par le gouvernement ramène le calme.
Le budget militaire de la France avec une augmentation de 50% entre 1905 et 1912 atteint plus de 1 280 millions de marks-or.
e) En Grande-Bretagne
L’armée britannique, formée uniquement de soldats professionnels, est peu nombreuse et principalement affectée dans les colonies. Face à la montée des périls, les généraux britanniques envisagent l’établissement d’un service militaire obligatoire. Dans un premier temps, le gouvernement refuse, trop préoccupé par le réarmement naval.
Ce n’est que vers 1907 que Richard Haldane, patron du War Office, met en place des mesures renforçant l’armée de terre, vigoureusement soutenu par Edward Grey, patron du Foreing Office et chaud partisan de l’alliance française ainsi que d’une intervention sur le continent en cas de conflit : Haldane uniformise les méthodes d’instruction dans l’ensemble de l’empire, créé une armée territoriale de réserve (277 000 hommes en 1910) et surtout la BEF (British Expeditionary Force, soit 6 divisions d’infanterie et 1 de cavalerie), pouvant rapidement être engagée sur le continent. L’effort budgétaire anglais est considérable : il atteint 1 640 millions de marks-or soit une hausse de 30% entre 1905 et 1912.
f) Autres états
La Belgique et les Pays-Bas, qui entendent observer une stricte neutralité, mènent cependant aussi une politique de réarmement : la Belgique adopte un projet de loi visant à permettre la création d'une armée de 330 000 hommes sur plusieurs années, tandis que les Pays-Bas et la Suède adoptent des lois visant au renforcement de leur appareil militaire…
« La rivalité économique avec l'Allemagne n'inquiète pas beaucoup nos gens, et ils admirent son industrie puissante et son génie de l'organisation. Mais ils n'aiment pas les trouble-fête. Ils soupçonnent l'empereur de « Weltpolitik » et ils voient que l'Allemagne accélère le rythme de ses armements pour dominer l'Europe, et impose ainsi une charge horrible de dépenses inutiles à toutes les autres puissances. En deux mots comme en cent, pour garantir la paix, nous devons maintenir notre entente avec la France. »
Lettre de Sir Edward Grey à Théodore Roosevelt, 1912.
VI Les tensions internationales et la crise des Balkans : 1908-1914
Entre 1870 et 1908, les acteurs majeurs dans la création d’un contexte favorable à l’éclatement d’une grande guerre sont incontestablement les trois grands impérialismes européens : le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Les systèmes d’Alliance sont en place et désormais relativement solides, mais la volonté de maintenir la paix l’emporte encore et à chaque fois, les négociations prennent le pas sur les velléités de quelques militaires d’aller au conflit.
A partir de 1908, plus précisément de l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie, le processus s’accélère et met en avant le rôle prépondérant des pouvoirs politiques « impériaux » comme l’Autriche-Hongrie, la Russie et la Turquie dans une région considérée comme la « poudrière de l’Europe » : les Balkans. Les grandes puissances vont se sentir entraînées dans une sorte d’engrenage fatal qu’aucune d’entre-elle ne saura - ou ne voudra - arrêter.
1. La désintégration progressive de l'Empire Ottoman
Malgré des nombreuses tentatives de réforme et de modernisation (Période dite « Tanzimat »), la Turquie reste au cours du XIXè siècle l’« Homme malade de l’Europe » et perd progressivement de nombreux territoires, particulièrement dans les Balkans : entre 1821 et 1830 la Grèce conquiert son indépendance ; en 1829 le traité d’Andrinople, suite à une guerre perdue contre la Russie, reconnaît l’autonomie de la Serbie, de la Moldavie et de la Valachie ; en 1830 la France pénètre en Algérie ; en 1841, c’est l’Egypte qui obtient son autonomie, puis le Monténégro la sienne en 1858. En 1876 le sultan Abdulhamid II suspend la constitution et impose un régime despotique de plus de 30 ans.
La désastreuse guerre contre la Russie (1877-1878) l’oblige par le traité de San Stefano, révisé par celui de Berlin (13 juillet 1878) à reconnaître l’indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro et l’autonomie de la Bulgarie, alors que l’Autriche impose son protectorat sur la Bosnie-Herzégovine et que Chypre passe sous domination anglaise. En 1881, la France impose son protectorat sur la Tunisie et l’année suivante la Grande-Bretagne occupe l’Egypte, alors que l’Italie s’implante progressivement en Cyrénaïque et Tripolitaine.
Pour tenter d’enrayer l’effondrement total de l’Empire, ponctué encore en 1898 par l’autonomie de la Crète, le Mouvement des Jeunes Turcs prend le pouvoir en juillet 1908 et impose au sultan le rétablissement de la constitution de 1876. Il faudra encore une année de troubles pour que les Jeunes Turcs s’imposent véritablement : le 24 avril 1909 le « Sultan rouge » est déposé et remplacé par son frère Mehmed V. C’est un pantin. Les véritables maîtres du pays sont désormais les Jeunes Turcs, avec le triumvirat Enver Pacha (1881-1922), Talaat Pacha (1874-1921) et Cemal Pacha (1872-1922).
Dans les Balkans, profitant de l’agitation turque, l’Autriche annexe officiellement la Bosnie-Herzégovine, tandis que la Bulgarie proclame son indépendance et la Crète son rattachement à la Grèce.
2. L’annexion de la Bosnier-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie : 1908
Jusqu’au début du XXè siècle, l'existence de l'Empire ottoman en Europe tient qu'au fait que l'Autriche et la Russie ne parviennent pas à tomber d'accord sur son démembrement et sur l'influence sur les États qui en sont nés. Par ailleurs, ni la France ni la Grande-Bretagne n’entendent laisser au Tsar dans le contrôle des détroits stratégiques du Bosphore et des Dardanelles. C’est ainsi que les grandes puissances, à l’initiative de Bismarck, obligent la Russie à une révision du traité de San-Stefano lors du congrès de Berlin, permettant à la Turquie de maintenir ses possession en Europe. Ainsi la Bosnie et l'Herzégovine restent la propriété des Ottomans tout en étant placés sous administration austro-hongroise comme spécifié dans l'article 25 de la conférence de Berlin. Immédiatement, le 29 juillet 1878, les armées de Vienne occupent la Bosnie et l'Herzégovine. Devant l’accueil hostile de la population, ils doivent recourir aux forces armées.
En 1903 cependant, Russes et Autrichiens signent le programme de Mürzsteg qu’ils imposent à la Turquie, afin de ramener le calme dans les Balkans, suite à des soulèvements anti-turcs en Macédoine. Par ailleurs, cette même année, en juin, le roi de Serbie Alexandre Ier, dernier roi de la dynastie des Obrenovitch, politiquement très proche de l’empire austro-hongrois, est assassiné par une groupe nationaliste et militariste qui amène au pouvoir Pierre 1er Karageorgévitch (1844 – 1903 – 1921), hostile aux Habsbourg et à « l'homme malade de l'Europe » (Empire Ottoman). Il met en place un régime constitutionnel très libéral, favorisant un foisonnement culturel intense, faisant de Belgrade un phare de liberté pour les Slaves de la région, particulièrement les Croates et les Slovènes, et donnant corps au rêve panslave d’une Yougoslavie indépendante de la tutelle autrichienne ou ottomane. Russophile et francophile, il se rapproche de Paris et Saint-Pétersbourg.
Cette émergence d’une Serbie démocratique est immédiatement ressentie à Vienne comme un danger mortel. Les relations entre les deux États sont sévèrement affectées et en 1905 les Serbes importent des munitions françaises, créent une union douanière avec la Bulgarie, et taxe lourdement les produits venant de l’empire austro-hongrois. En réponse, l’Autriche mène l'agriculture serbe au bord de la ruine en 1906 en fermant les frontières à la viande de porc serbe (la « guerre des cochons »). La Serbie obtient des prêts de la France pour développer son industrie destinée au commerce international, achète des produits à l'Allemagne, et cherche un accès à la mer Adriatique. La Russie affirme son soutien à Belgrade.

"The boiling point", caricature de Léonard Raven-Hill parue dans le Punch le 2 October 1912, à propos de la crise des Balkans.
Affiche. Document Commons Wikimedia. Kursbuch Geschichte - Nordrhein-Westfalen. Domaine public., 2015
La situation se détend en 1908, suite aux évènements en Turquie, donnant à Vienne l’occasion d’avancer ses pions dans les Balkans : pour cela, l’Autriche calme le jeu avec Saint-Pétersbourg : Alois von Aehrenthal, le nouveau ministre austro-hongrois des Affaires étrangères, négocie un accord avec son homologue Alexandre Izvolski, ministre des Affaires étrangères de la Russie, avec le soutien du tsar. Les deux hommes se rencontrent le 16 septembre 1908 à Buchlau en Moravie et mettent au point leur accord dans le plus grand secret : l’Autriche-Hongrie s’adjugerait la Bosnie-Herzégovine et la Russie obtiendrait la libre circulation dans le Bosphore et les Dardanelles. Pour Vienne, ce serait une compensation des territoires perdus en Vénitie et en Lombardie lors de l’unification italienne ; mieux : on envisage sérieusement à Vienne, sous la pression du chef de l'État-major Franz Conrad von Hötzendorf, d’envahir dans la foulée la Serbie, le Monténégro, l’Albanie et la Macédoine occidentale afin de réunir les Slaves du Sud soumis à l'Empire habsbourgeois et de faire de Thessalonique en bastion autrichien en bordure de la Mer Égée.
Izvolski pense alors négocier cet accord avec Paris et Londres, mais le 6 octobre l'Autriche-Hongrie précipite les évènements et annexe purement et simplement la Bosnie-Herzégovine, laissant les Russes totalement surpris, d’autant que Paris et Londres, tout en hurlant parce qu'on ne respectait pas à la lettre le Traité de Berlin, n’entendent absolument pas laisser à Saint-Pétersbourg les mains libres dans les détroits, malgré l’Entente. Même levée de boucliers à Belgrade et dans les milieux panslaves, ainsi qu’en Turquie, mise devant le fait accompli. Les Russes demandent alors la réunion d’une conférence internationale.
Pour ne rien arranger, la Bulgarie, autonome depuis le congrès de Berlin, en profite pour déclarer son indépendance et le 6 octobre le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha se proclame tsar de Bulgarie sous le nom de Ferdinand 1er, ce qui ne fait ajouter qu’à la confusion, le nouveau souverain n’étant agréé ni par Saint-Pétersbourg, ni par Vienne, ni par la Sublime Porte.
La crise s’estompe en mars 1909, lorsque l’Autriche-Hongrie menace la Serbie d’une intervention militaire et lorsque le chancelier allemand von Bülow prononce au Reichstag le 29 mars 1909 un très important discours, reçu à Vienne avec enthousiasme : il y fait comprendre au gouvernement russe que les Autrichiens pourraient effectivement entrer en guerre contre la Serbie et demande l'arrêt des aides russes à Belgrade. Surtout, il affirme avec force le soutien inconditionnel du Reich à l’Autriche en cas de conflit, utilisant le terme lourd de sens de « Nibelungentreue », terme médiéval désignant les liens indéfectibles unissant un vassal à son seigneur… L’Allemagne a clairement choisi son camp. De son coté, la France refuse de faire jouer son alliance avec la Russie et conseille la modération à la Serbie. Deux jours plus tard la double monarchie obtient, le 31 mars 1909, de la Serbie, isolée, la reconnaissance du « fait accompli ».
Par sa prise de position cependant, l'empire allemand brusque la Russie et la Grande-Bretagne qui ne voulaient pas reconnaître l'annexion, renforce le panslavisme de la Serbie et ne fait qu’exacerber les tensions régionales, préparant un nouveau conflit dans les Balkans.
3. La première guerre balkanique : 1912
La Serbie, malgré le coup d’arrêt de 1908, ne renonce pas à son leadership sur le monde slave. D’autant qu’en Autriche-Hongrie de nombreux tenants de la solution fédérale verraient d’un bon œil la création d’un troisième pôle, slave du Sud, centré autour des Croates : une telle entité ferait contrepoids à l'influence d’une Serbie marginalisé, limiterait aussi l'influence magyare au sein de la double monarchie et enfin bloquerait les velléités italiennes en Dalmatie.
A défaut donc d’affronter l’Autriche-Hongrie, la Serbie tourne ses regards vers l’empire ottoman en pleine décomposition, spécialement vers ses possessions européennes… L’occasion est fournit lorsque l’Italie entre en guerre contre la Sublime Porte en septembre 1911 pour se créer un empire colonial en Libye et Tripolitaine (avec l’aval de la France, ayant alors les mains libres en Tunisie…) et pour occuper les iles du Dodécanèse.

Les délégués de la ligue balkaniques à la conférence de Londres.
Montage Montage Georges Brun sur un document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Dès mars 1912, sous le patronage de la Russie, des traités sont signés entre la Serbie et la Bulgarie, puis entre la Bulgarie et la Grèce. Le Monténégro rejoint les trois autres pays pour former la Ligue Balkanique. Ainsi le Tsar veut revenir en force dans les Balkans, tout en maintenant le statut-quo. Mais la situation lui échappe, car le 15 octobre 1912, la ligue entre en guerre contre la Turquie.
En 5 mois, la Turquie est défaite sur tous les fronts européens et sur mer. Le 30 mai est signé le traité de Londres : depuis décembre 1912, les grandes puissances (France, Allemagne, Italie, Russie, Autriche-Hongrie et Royaume-Uni) ont en effet créé la conférence de Londres pour conserver la maîtrise des conséquences de la guerre en cours.
Il est décidé que Roumélie ottomane, à l'ouest « d'une ligne tracée d'Enos sur la mer Égée à Midia sur la mer Noire » est transférée aux quatre puissances coalisées de la ligue. Il est en même temps décidé la création d’une Albanie indépendante (au grand dam de la Serbie), alors que la Crête est transférée à la Grèce. Enfin, et cela est capital, la répartition des territoires entre la Ligue (Macédoine, Thrace, Kossovo…) n’est pas définie : cette décision engendre immédiatement de graves tensions entre les vainqueurs.
4. La seconde guerre balkanique : 1913
Les grands bénéficiaires de cette première guerre sont la Grèce et la Serbie, qui voit son blason totalement redoré, ce qui contrarie la cour de Vienne. La pomme de discorde entre les vainqueurs est la Macédoine, presque totalement occupée par la Bulgarie. La Grèce réclame la Macédoine du Sud, la Serbie celle du nord. Les négociations n’aboutissant pas, la Bulgarie, soutenue par Vienne, décide de recourir aux armes et réunit ses troupes en Thrace Orientale.
Alors que le traité de Londres n’est même pas signé, Grèce et Serbie règlent leur petit différend, signent une alliance militaire le 1er mai puis un traité d'assistance mutuelle le 1er juin, dirigé contre la Bulgarie. La Russie, qui veut absolument maintenir la Ligue balkanique dans laquelle elle voit la principale garantie contre l’expansion austro-hongroise, tente la médiation, alors que la Roumanie réclame de la Bulgarie la cession de la forteresse ottomane de Silistra comme cela était convenu avant la première guerre balkanique. De son côté, la Turquie n’a pas renoncé à reprendre pied en Thrace occidentale.
Tout commande donc la prudence à la Bulgarie. Mais le fantasque Ferdinand I n’en a cure : sûr de la force de son armée et du soutien populaire, il refuse la médiation russe.
Le 16 juin 1913, la Bulgarie (600 000 hommes) attaque les forces grecques (142 000 hommes) et serbes (252 000 hommes), provoquant l’entrée en guerre contre elle des forces monténégrines (12 000 hommes), roumaines (330 000 hommes) et turques (255 000 hommes).
Avant même l’intervention roumaine, l’armée bulgare subit échec sur échec contre la Grèce et la Serbie. Début juillet, l’armée roumaine se met en marche vers Sofia, puis les Ottomans marchent sur Andrinople. Vienne souhaite une intervention militaire aux côtés de la Bulgarie, mais Berlin l’en dissuade fermement. Le 18 juillet, la Bulgarie demande la médiation de la Russie qui impose la fin des hostilités aux belligérants.

Scènes de la seconde guerre balkanique.
Montage. Montage Georges Brun d'après des document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Aux traités de Bucarest (10 août 1913) et de Constantinople (29 septembre), la Bulgarie perd pratiquement tous les territoires acquis lors de la première guerre balkanique : elle cède la Macédoine à la Grèce et à la Serbie, la Dobroudja du sud à la Roumanie, Andrinople et sa région à la Turquie.
Cette guerre suscite l’émoi dans toute l’Europe et raidit encore les positions des grandes puissances : ni la France, ni le Reich cependant ne veulent une guerre pour les Balkans, n’étant pas encore prêts. Mais le 3 juillet, les effectifs de l’armée allemande sont revus à la hausse ; en réponse, le Parlement français porte la durée du service militaire obligatoire à 3 ans. France, Grande-Bretagne et Russie resserrent leurs liens alors que l’Allemagne renforce les siens avec la double monarchie et cherche de nouvelles alliances, notamment celle de l’empire ottoman. Se sentant terriblement isolée et surtout encerclée de toute part, sachant que le temps joue contre elle, elle sait la guerre inévitable.
Grande bénéficiaire de la guerre, la Serbie double la superficie de son territoire et augmente sa population de 2,9 à 4,5 millions d'habitants. Son prestige vis-à-vis des populations slaves des Balkans est considérablement renforcé et ses liens avec la France et la Russie plus solides que jamais. Elle peut désormais se consacrer pleinement à son objectif : la création d’une « Yougoslavie » au détriment de l’Empire Austro-Hongrois. Belgrade tourne ses regards vers la Bosnie… De son coté, le gouvernement austro-hongrois, de plus en plus influencé par la caste nobiliaire guerrière, s’oriente inéluctablement vers une intervention punitive contre la Serbie désormais remise en selle. Le chef d’état-major Conrad Von Hoetzendorf (1852-1925) s’en tient à un mot d’ordre sans nuance : « la guerre, la guerre, la guerre »
Déçue par le traité qui lui aliène l’Épire du Nord et la Thrace occidentale, la Grèce parvient à conserver la région de Serrès et de Kavala, avec le soutien de l’Allemagne, vers laquelle la Monarchie hellène se tourne de plus en plus.
L’Albanie voit son indépendance confirmée, soutenue à la fois par l’Italie et l’Autriche-Hongrie, en compétition pour le contrôle du canal d’Otrante et donc du débouché de la mer Adriatique… La Bulgarie de son côté bascule par esprit revanchiste dans le camp des Empires centraux, alors que la Roumanie va rejoint la Triple-Entente malgré les sympathies du roi Carol pour sa patrie d'origine, l'Allemagne. Les pions se mettent en place.

Carte des Balkans entre 1840 et 1878. Si la Turquie reste encore une puissance incontournable dans cette région stratégique de l’Europe, elle est cependant sur le reculoir : obligée de reconnaître l’indépendance de la Grèce, elle doit accordre l’autonomie à de vastes territoires qui vont former la future Serbie et la future Roumanie, alors que l’empire austro-hongrois s’apprête à faire main basse sur la Bosnie-Herzégovine.
Carte. Georges Brun., 2015

Les Balkans à la veille de la première guerre balkanique. En plein recul, l’empire ottoman se voit contesté ses possessions européenne par de petits pays derrière lesquels agissent les deux grandes puissances régionales, Russie et Autriche-Hongrie, en féroce concurrence pour le contrôle des fameux Détroits.
Carte. Georges Brun., 2015

Carte des Balkans après la première guerre balkanique et le traité de Londres. Le traité de Londres qui clôt la première guerre balkanique frustre de fait tous les belligérants : la Turquie qui perd la plus grande partie de ses territoires européens, mais aussi ses vainqueurs, incapables de s’entendre sur le partage de leurs conquêtes. Bientôt, la rivalité entre Serbie et Bulgarie va déclencher un nouveau conflit armé.
Carte. Georges Brun., 2015

Carte des Balkans en 1914, après la seconde guerre Balkanique. Sortant victorieuse de cette guerre, la Serbie perd toute prudence vis-à-vis de son puissant voisin austro-hongrois, alors que la Bulgarie rumine sa vengeance, qui la fera basculer lors de la Grande Guerre dans le camp de la Triplice.
Carte. Georges Brun., 2015
5. La question turque en 1914
La déroute balkanique place le gouvernement des Jeunes Turcs dans une position extrêmement délicate. Afin d’éviter un effondrement total il leur est impératif de restaurer l’outil militaire, garant de l’indépendance nationale. Les militaires turcs se tournent naturellement vers l’Allemagne, ayant déjà fait venir une première mission militaire, celle de Colmar von der Glotz (1843-1916) à la fin du XIXè. La délégation que Berlin envoie fin 1913 est autrement plus musclée : son chef, Liman von Sanders (1855-1929), est responsable de la formation de toute l’armée turque et supervise la défense des Détroits. Mais, en ce qui concerne sa marine, la Sublime Porte fait appel aux Anglais et leur commande deux cuirassés de type « dreadnought », de dernière génération.

La « Teutonisation de la Dinde » (en anglais, Turkey signifie « Dinde ») Montrant Guillaume II faisant parader la dinde avec les mots suivants : « It's as easy as eins! zwei! drei! » (« C’est aussi facile que un ! deux !trois ! » Caricature du journal anglais « Punch » d'octobre 1905.
Affiche. Ph. Townsend., 2015
Les Allemands se montrent cependant très prudents : les guerres balkaniques ont montré à quel point l’armée ottomane est faible et savent qu’à terme la dissolution de l’empire est inéluctable, mais, que le moment venu, elle devrait y prendre part et s’adjuger une zone d’influence, du centre de l’Anatolie à la frontière perse. Les Turcs sont de leur côté déçus de l’attitude allemande, car Berlin n’a pas bougé durant les guerres balkaniques, a soutenu son allié italien en Tripolitaine et la Grèce lors de la délimitation de la frontière avec l’Albanie.
Mais plus que tout, ils craignent les ambitions russes, au moment où Saint-Pétersbourg se rapproche de Londres pour proposer début 1914 la création d’une grande région autonome d’Arménie et d’internationaliser Constantinople… Ce rapprochement anglo-russe terrifie Berlin : l’alliance d’un potentiel démographie russe colossal et d’une marine de guerre sans égale capable d’étrangler le commerce maritime de n’importe quel pays viendrait aisément à bout du Reich, réglant le facto la question des Détroits… La France de son côté investit énormément en Turquie où elle concurrence sérieusement les Allemands.
L’attentat de Sarajevo brusque les choses : les Turcs y voit une excellente occasion de revenir sur la scène internationale et de mettre fin au processus de démembrement. Ils proposent donc à Berlin de s’allier à la Bulgarie et d’adhérer à la Triplice pour combattre à ses côtés. Vienne appuie immédiatement la proposition turque, mais à Berlin on est beaucoup plus prudent : le 14 juillet, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Gottlieb von Jagow (1863-1935), rejette les avances turques : pour lui, l’armée ottomane n’est absolument pas prête et la Triplice n’est pas en mesure d’assurer la défense des frontières ottomanes.
Enver Pacha insiste, menaçant même et lors d’un entretien avec l’ambassadeur d’Allemagne à Constantinople, Hans Freiherr von Wangenheim (1859-1915), de se placer sous la protection de l’Entente, si la Wilhelmstrasse continue à ignorer ses appels. Ces propos font une profonde impression sur le Kaiser, très populaire dans le monde islamique et qui refuse de tirer un trait sur des décennies d’investissements allemands dans le pays, notamment en Anatolie et dans le Bagdadbahn.
Aussi le chancelier Bethmann-Hollweg rédige un accord qui est signé le 2 août 1914 et qui stipule :
• L’Empire ottoman s’engage à déclarer la guerre à la Russie si les Russes attaquent l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.
• La mission de Liman von Sanders est maintenue. En cas de conflit, elle est intégrée aux forces armées ottomanes.
• L’Allemagne s’engage à défendre l’intégrité de l’Empire ottoman.
• Le traité, limité à la durée de la crise Austro-serbe, sera prorogé jusqu’en 1918.
L’erreur des Turcs sera de croire à une guerre limitée entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie, ignorant que le plan Schlieffen mis en œuvre au même moment induit mécaniquement la belligérance française et britannique.
Aussi, la guerre engagée en Occident, les Turcs marquent un temps d’hésitation lorsqu’ils apprennent les défaites allemande et austro-hongroise sur la Marne, en Galicie et en Serbie. Les Allemands engagent alors de gros moyens financiers et accélèrent la modernisation de l’armée turque. Deux croiseurs allemands, le Goeben et le Breslau, sont transférés à la marine turque et rebaptisés Yavuz et Midilli, échappant ainsi aux canons de la marine anglaise. Le 29 octobre, l’amiral allemand Wilhelm Souchon (1864-1946), à la tête d’une une escadre turque comprenant le Yavuz et le Midilli, bombarde le port russe d’Odessa. La Russie n’en attendait pas tant : elle déclare la guerre à la Sublime Porte, suivie le 2 novembre par la France et l’Angleterre.
« Quand je vois tout ce que la Russie a fait pendant des siècles pour notre destruction, et tout ce que la Grande-Bretagne a fait ces dernières années, je considère la crise actuelle comme une bénédiction. Il appartient à chacun d’entre nous de vivre debout ou bien de sortir glorieusement de l’histoire ».
Cemal Pacha, 2 novembre 1914.
VII La crise de juillet 1914
1. Sarajevo et la réaction autrichienne
Capitale de la Bosnie-Herzégovine, berceau de groupes nationalistes serbes et bosniaques, Sarajevo reçoit le 28 juin 1914, date anniversaire de la bataille de Kosovo (28 juin 1389) remportée par les Turcs sur les Serbes, l'héritier de l'Empire austro-hongrois François-Ferdinand et son épouse Sophie Choteck. Après avoir échappé à un premier attentat, le couple est assassiné peu avant 11 heures par un étudiant serbe de Bosnie, Gavrilo Princip.
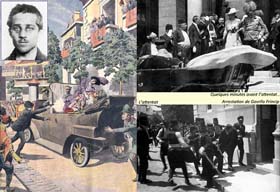
L'attentat de Sarajevo. A gauche, la page de garde du supplément illustré du Petit Journal du 12 juillet 1914 montrant l’assassinat de l'Archiduc héritier d'Autriche et de la Duchesse sa femme ; en médaillon, portrait de l’assassin, Gavrilo Princip, lors d’un des nombreux interrogatoires. En haut à droite, le départ du couple princier de l'hôtel de ville, cinq minutes avant l'assassinat ; en bas, l'arrestation de Princip, photo qui d’ailleurs fait débat: de nombreux spécialistes pensent que le document représente l'arrestation de Ferdinand Behr, un spectateur qui a été soupçonné d'implication dans l'assassinat. .
Affiche. Documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
A Vienne, le ministre des affaires étrangères de l'Autriche, le comte Léopold von Berchtold (1863-1842) et le chef des armées von Hötzendorf sautent immédiatement sur l’occasion : c’est le moment d’agir militairement contre la Serbie, mais dans le cadre d’une guerre limitée.
« ob man warten solle, bis Frankreich und Russland bereit wären, uns gemeinsam anzufallen, oder ob es nicht wünschenswerter wäre, dass der 'unvermeidliche' Konflikt früher beginnen würde; auch die slawische Frage gestalte sich immer schwieriger und gefährlicher. » « Devons nous attendre que la France et la Russie soient prêtes à nous attaquer conjointement, ou bien n’est-il pas plus souhaitable que l’inévitable conflit ne débute plus tôt ? La question slave se présente de plus en plus difficile et dangereuse. »
Franz Conrad von Hötzendorf.
On est persuadé à Vienne que l’attentat est l’œuvre de la Main Noire, organisation ultranationaliste serbe plus ou moins pilotée par Belgrade. Preuve en sont, pour les Autrichiens, l’enthousiasme populaire que l’assassinat déclenche en Serbie, le déchaînement de la presse serbe contre l’Autriche et le peu d’empressement que met le pouvoir officiel de Belgrade à adresser ses condoléances à Vienne ; il ne fera d’ailleurs rien pour apaiser les esprits…
Le 30 juin 1914, le comte Berchtold et Conrad Von Hoetzendorf rencontrent l’empereur : tous trois s’entendent pour utiliser l’assassinat de l’archiduc comme prétexte afin d’« éliminer la Serbie comme puissance politique » et de rétablir ainsi la puissance austro-hongroise sur la scène européenne.
Mais il faut à Vienne des garanties de Berlin… et convaincre Istvan Tisza, président du conseil hongrois, qui ne veut pas de guerre, car il craint la réaction des populations slaves, majoritaires en Hongrie.
2. La réaction allemande : le blanc-seing
Le 5 juillet 1914, François‑Joseph, dans un télégramme à Guillaume II évoque l’éventualité d’une action militaire contre la Serbie. Le même jour, le comte Alexander von Hoyos (1876-1927) chef de cabinet au Ministère des Affaires étrangères est envoyé à Berlin.
Pour l’empereur, il faut intervenir. Dès qu’il apprend la nouvelle de l’attentat, il s’écrie : « Jetzt oder nie ! Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald », « Maintenant ou jamais ! Il faut en finir avec les Serbes, et rapidement ! »
Pour le chef d’état major, Helmut von Moltke, il ne reste à l’Allemagne d’autre choix que de livrer une guerre préventive, tant que cette guerre pouvait encore être à l’avantage de l’Allemagne… Il avise le secrétaire d’état aux affaires étrangères Gottlieb von Jagow: « unsere Politik auf die baldige Herbeiführung eines Krieges einzustellen. », « de calquer notre politique sur une mise en œuvre d’un processus rapide d’entrée en guerre… »

Les principaux acteurs de la crise de juillet 1914 qui va mener à la guerre.
Montage. Montage Georges Brun., 2015
C’est sans doute la position du chancelier Bethmann-Hollweg qui fait pencher la balance : jusqu’à présent il s’est toujours opposé à l’état-major, plaidant pour une guerre préventive, car pour lui, la France et la Russie ne seront prêtes à une guerre qu’en 1916-17. Cette fois-ci, il soutient les militaires, dans l’illusion que cette guerre serait limitée aux Balkans. Le Conseil impérial se réunit le 5 juillet. Tout en s’opposant aux plans de guerre de von Moltke contre la France et la Russie, le chancelier conseille au Kaiser une intervention limitée aux Balkans.
Guillaume II pousse donc Vienne à agir rapidement et fermement, car la vague d’indignation dans toute l’Europe est en train de créer un climat propice à des actions militaires préventives contre la Serbie… Une action diplomatique rapide et purement formelle (ultimatum inacceptable pour la partie adverse) suivie d’une intervention armée tout aussi rapide devrait empêcher le jeu des alliances, l’action militaire mettant la France et la Russie devant le fait accompli… Le Kaiser est d’ailleurs convaincu qu’alors la Russie n’interviendrait pas aux côtés de « Bandits et de régicides », que l’armée du tsar n’est d’ailleurs pas prête et qu’à Paris on ne mourrait pas pour Belgrade. Au pire, même en cas d’intervention russe et française, on se sent prêt à Berlin : si Saint-Pétersbourg intervient, l’Allemagne respectera ses engagements vis-à-vis de Vienne. Personne, à ce moment précis, n’envisage l’éventualité d’une entrée en guerre de la Grande-Bretagne.
Aussi, le 6 juillet 1914, Théobald von Bethmann‑Hollweg envoie un télégramme à l’ambassadeur d’Allemagne à Vienne : « Kaiser Franz Josef könne sich darauf verlassen, daß Seine Majestät im Einklang mit seinen Bündnispflichten und in seiner alten Freundschaft getreu an der Seite Östereichs Ungarns stehen würde. » « L’empereur François-Joseph peut être assuré que Sa Majesté se tiendra fidèlement aux côtés de l’Autriche-Hongrie, en accord avec les engagements de l’alliance et par amitié ! »
Le chancelier du Reich supprime cependant l’ajout « en toutes circonstances » dans le projet de télégramme initial. C’est le fameux « blanc-seing » ou « Blankoscheck », qui constitue un jalon majeur dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Ce même jour, pour bien montrer que le conflit ne doit pas déborder du cadre local austro-serbe, le Kaiser part pour une croisière de trois semaines (6-27 juillet) le long des côtes norvégiennes sur son yacht « Hohenzollern » ! Bethmann Hollweg reste à Berlin pour diriger la mise en œuvre de la stratégie convenue.
Mais les stratèges de Berlin et de Vienne ont joué au poker, car rien ne se passe comme prévu :
• Contrairement aux spéculations de Berlin, la Russie n’entend absolument pas assister sans bouger à une action de guerre de l’Autriche-Hongrie contre la Serbie, bien au contraire. Convaincu par son entourage militaire du haut niveau de préparation et de détermination de son armée (ce qui est totalement faux), Nicolas II est déterminé à soutenir militairement la Serbie : il faut disputer au Reich son leadership européen ; il faut se positionner comme la puissance protectrice de tous les slaves ; il faut enfin effacer la honte de 1905. Berlin et Vienne ont totalement sous-estimé la détermination de Saint-Pétersbourg.
• Vienne ne comprend pas qu’il faut agir dans les plus brefs délais. A partir de la réponse de Berlin du 5 juillet, l’Autriche met 18 jours pour lancer son ultimatum à Belgrade, compromettant totalement l’effet de surprise sur lequel comptait Berlin ! Une grande partie des soldats sont en effet en permission pour les moissons : les rappeler immédiatement éveillerait des soupçons. D’autre part, Vienne doit convaincre Budapest et son ministre hongrois Istvan Tisza, de la nécessité de la guerre : ce dernier ne se rangera du côté des bellicistes qu’au conseil du 14 juillet. Enfin, le rapport de la commission d’enquête ne parvient pas à établir avec certitude que Belgrade ait armé le bras de Princip.
3. L’ultimatum du 23 juillet 1914
Parti de France en bateau le 13 juillet, le président Poincaré arrive à Saint-Pétersbourg le 20 pour un voyage officiel de 3 jours, dont il ne reviendra que le 29. France et Russie renouvellent leur alliance en cas de guerre imminente, mais Paris conseille la plus grande prudence ; il semble à ce moment que Nicolas II se soit rangé du côté de la modération. Le 21 juillet cependant, la Russie met en garde Vienne en cas d’intervention contre Belgrade.
Le 23 juillet 1914 au soir, alors que le bateau de la délégation française a levé l’ancre et navigue vers Stockholm, alors que dans toute l’Europe la tension est retombée, l'Autriche-Hongrie adresse à la Serbie une note diplomatique et un ultimatum en dix points, rédigé de telle manière qu’il soit inacceptable, et demande une réponse sous 48 heures. La note rappelle les griefs de Vienne à l’encontre de la Serbie sans cependant l’accuser d’avoir ourdi l’attentat, sinon d’avoir encouragé les comploteurs de la « Main Noire ». L’ultimatum exige des Serbes l’engagement officiel de ne plus accepter en Bosnie de menées terroristes et d’interdire toute forme de propagande antiautrichienne sur son sol. C’est une véritable humiliation pour Belgrade. Surtout, les articles 5 et 6 exigent que la Serbie accepte qu’intervienne sur son propre sol une commission d’enquête austro-hongroise chargée de rechercher les coupables et de mettre fin aux actions subversives.

Le voyage du président Poincaré en Russie. Accompagne du président du conseil Viviani, Poincaré vient rassurer Nicolas II et surtout calmer le tsar dont les intentions belliqueuses sont très claires. Il repartira rassuré, mais Nicolas II ne tiendra pas ses engagements de paix.
Montage. Montage Georges Brun, documents domaine public., 2015
Le gouvernement serbe est fortement ébranlé. Conscient qu’il ne peut, dans les 48 heures, guère attendre de soutien ferme en Europe vu sa mauvaise réputation, il est prêt à accepter les conditions autrichiennes, mais décide de consulter Saint-Pétersbourg : le 24, le prince Alexandre télégraphie au tsar que la Serbie ne peut se défendre toute seule et qu’elle est prête à accepter les points de l’ultimatum que les Russes lui conseilleraient d’accepter. Immédiatement, Saint-Pétersbourg demande à Vienne une prolongation du délai imparti à la Serbie.
Le 25 au matin, la réponse de Saint-Pétersbourg arrive à Belgrade : le tsar fait savoir qu’il soutiendra la Serbie et, que le cas échéant, il décrèterait une « période de préparation à la guerre », à savoir une procédure de pré-mobilisation. Pour la Russie, inutile de consulter son principal allié, la France, dont le président est alors en haute mer.
Le gouvernement serbe rédige alors sa réponse à l’ultimatum autrichien : il en accepte tous les points, hormis les articles 5 et 6 qu’il propose cependant de soumettre à l’arbitrage de la cour internationale de Justice. Peu avant 18 heures, le Premier ministre Nicolas Pasic remet à l'ambassadeur austro-hongrois Wladimir Giesl von Gieslingen (1860-1936) la réponse du gouvernement serbe. Sur ordre du ministre des Affaires étrangères le comte Berchtold, qui juge la réponse insuffisante, l’ambassadeur rompt officiellement les relations diplomatiques avec la Serbie et rentre en Autriche avec la délégation de l’ambassade, alors que Vienne signifie à Saint-Pétersbourg le refus de prolonger le délai demandé. L’irrémédiable est en train de se produire.
4. L’engrenage
Les termes de l’ultimatum autrichien sont rapidement connus en Europe : ils y provoquent la stupeur, tant ils sont durs et humiliants. Cependant, la plupart des pays européens non concernés par les alliances, tout en prêchant la modération, reste dans une prudente neutralité : Norvège, Danemark et Pays-Bas craignent une invasion allemande ; la Suède se méfie de son voisin russe ; l’Espagne assure la France de sa neutralité, ainsi que le Portugal…
A Londres, Sir Edward Grey, ministre britannique des Affaires Étrangères, propose sa médiation pour prolonger l’ultimatum autrichien.
Le lendemain 26 juillet, Berlin signifie à Vienne et à Rome sa volonté de limiter le conflit à l’échelon purement local. L’Autriche-Hongrie commence à mobiliser… ainsi que le Monténégro, qui cependant hésite encore dans le choix de ses alliances. La Bulgarie, suivant son allié autrichien, rompt ses relations avec la Serbie, qui mobilise. Au même moment, à Saint-Pétersbourg, le conseil des ministres russe prend la décision de mobiliser à titre de prévention. Une nouvelle médiation de Sir Edward Grey, avec l’appui de la France, essuie un refus catégorique de Berlin et de Vienne. Paris décide d’annuler toutes les permissions en cours de ses soldats.
Le 27 juillet, Londres effectue une troisième tentative de médiation et demande à Berlin d’intervenir auprès de Vienne pour préserver la paix en acceptant la proposition serbe. Edward Grey propose la tenue d’une conférence de médiation réunissant les 4 puissances non directement engagées (Grande-Bretagne, France, Allemagne et Italie). Berlin cherche des faux-fuyants, ce qui équivaut à un refus. L’Autriche et la Serbie poursuivent leur mobilisation. Le président Poincaré et le président du conseil Viviani décident de rentrer le plus vite possible en France. En Allemagne, deux classes de réservistes sont rappelées et les navires de guerre rallient leurs ports d’attache. Les Anglais rassemblent leur escadre de Méditerranée à Malte.
Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie notifie officiellement à la Serbie la déclaration de guerre. A cet instant précis, seule Vienne, totalement confiante dans le soutien allemand, est sûre de son fait : elle fera la guerre.
A Berlin, Guillaume II, de retour de vacances, note à propos de l’ultimatum autrichien « Un grand succès moral pour Vienne ; mais tous les motifs de guerre ont disparu ... à ce moment-là, jamais je n’aurais conseillé la mobilisation générale ! » : il pense que le conflit et encore évitable, que la Serbie à déjà reçu une bonne leçon et qu’une guerre entraînerait un massacre ; d’autant que l’ambassadeur allemand à Londres, Karl Max von Lichnowsky (1860-1928), extrêmement lucide sur la situation, met en garde Bethmann-Hollweg et Guillaume II des risques d'une guerre générale, car il est sûr de l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne aux côtés de la France.
De même, à Saint-Pétersbourg, Nicolas II reste très hésitant : il est assez lucide sur l’état de son armée et ne veut pas jouer les jusqu’auboutistes… Dans la journée, un télégramme de son cousin le Kaiser le rassure : lui aussi veut éviter un conflit général. La Grande-Bretagne de son côté maintient ses propositions de conférence pour sauver la paix.
Saint-Pétersbourg choisit alors une solution intermédiaire : le tsar ordonne le 29 juillet, sans concertation avec ses alliés français et anglais prévue par les accords militaires franco-russes, la mobilisation partielle contre l’Autriche-Hongrie. 700 000 hommes sont massés le long de la frontière austro-hongroise, soit 14 corps d’armée, recrutés dans les gouvernorats de Kiev, Odessa, Kazan et Saint-Pétersbourg.
Le jour même, Poincaré et Viviani rentrent à Paris, furieux de la décision de Saint-Pétersbourg. L’Allemagne rappelle ses permissionnaires, l’Angleterre hâte la concentration de ses flottes. Tout reste encore possible, même si, sur le Danube, la flotte autrichienne bombarde Belgrade. Sir Edward Grey tente une dernière médiation, demandant à Berlin d’intervenir auprès de Vienne, allant jusqu’à reconnaître à l’Autriche-Hongrie le droit d’occuper Belgrade…
Mais tout bascule le 30 juillet à Saint-Pétersbourg : l’ambassadeur d’Allemagne proteste contre la mobilisation russe et signifie que cette mobilisation, même partielle, aura pour conséquence la mobilisation allemande. Sergueï Sazonov (1870-1927), ministre des Affaires étrangères, lui répond de l’impossibilité de stopper la mobilisation puis, en accord avec les généraux russes, qui ne rêvent que d’en découdre, persuade le tsar de décréter la mobilisation générale. A 18h00, Nicolas II s’incline et ordonne la mobilisation générale qui s’étend donc à la frontière de l’Allemagne.
Le lendemain, 31 juillet, devant le refus du Tsar de stopper la mobilisation générale, et sous la pression de l’Etat-major allemand et particulièrement de Falkenhayn, le Kaiser proclame le « Kriegsgefahrzustand » (état de danger de guerre), instaure la dictature militaire, engage la mobilisation sur sa frontière ouest et confirme à la Belgique son refus de respecter sa neutralité. Bruxelles mobilise ; Nicolas II ordonne la mobilisation des réservistes alors que l’Autriche redouble ses attaques contre les Serbes et poursuit le bombardement de Belgrade.
France et Royaume-Uni tentent encore la négociation ; en signe d’apaisement vis-à-vis du Reich, Adolphe Messimy (1869-1935), ministre de la guerre français, ordonne aux troupes françaises de se retirer à 10km derrière la frontière : l’armée française abandonne ses positions sur les crêtes vosgiennes. A Londres, Sir Edward Grey prévient que si l'Allemagne et la France venaient à être entraînées dans le conflit, la Grande-Bretagne ne resterait pas à l’écart et demande aux deux pays s’ils comptent respecter la neutralité belge : la France donne immédiatement des assurances, mais l’Allemagne reste muette.
Ce même jour, à 21h40, Jean Jaurès est assassiné à Paris par un étudiant nommé Raoul Villain.
Le 1er août 1914, l’Allemagne envoie simultanément un ultimatum à la Russie et à la France : Saint-Pétersbourg a 12 heures pour suspendre sa mobilisation et Paris 18 heures pour faire connaître sa neutralité en cas de guerre avec la Russie. En garantie de cette neutralité, Berlin exige de la France la remise des places-fortes de Toul et Verdun… La France fixe pour le lendemain la mobilisation générale de son armée. A Londres, Winston Churchill, Premier Lord de l'Amirauté, décide de mobiliser la Home Fleet afin de venir en aide à la France, avec l'accord tacite du Premier ministre Asquith, et malgré une réponse évasive de George V à Poincaré.
Dans la soirée, après avoir signé un traité d’alliance avec l’empire Ottoman contre la Russie, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Les troupes russes franchissent en plusieurs points la frontière de la Prusse Orientale.
Dans la journée du 2 août, alors que débute la mobilisation générale en France, l’armée allemande envahit le Luxembourg et adresse un ultimatum à la Belgique neutre afin qu’elle laisse le passage à ses troupes, sous le prétexte que la France ferait de même pour l’agresser. Les premières escarmouches ont lieu sur la frontière alsacienne.

Page de garde du quotidien allemand "Lubeckische Zeitung" annonçant, sous les portraits du Kaiser Guillaume II et de l'empereur François-Joseph, la mobilisation générale, en date du 2 août 1914. En titre, la célèbre formule, "Deutschland, Deutschland über alles !"
Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015
Le 3 août 1914, Albert I, roi des Belges rejette l’ultimatum allemand. A 17 heures, le baron Wilhelm von Schoen (1851-1933), prétextant un incident de frontière, remet au président du Conseil français René Viviani une note selon laquelle le gouvernement allemand se considère en état de guerre avec la France, puis quitte Paris. Peu après, une notification de guerre est adressée à Bruxelles. Les Allemands sont en effet pressés par le temps : ils savent que la Russie mobilisera beaucoup plus lentement que la France, et pour éviter de se battre sur deux fronts, doivent vaincre l'armée française le plus rapidement possible en l'attaquant par la Belgique, puis régler son compte à la Russie. Leur plan est dans les cartons depuis quelques années : c’est celui du fameux comte Schlieffen. Plus on attend à Berlin, plus on se met en danger.
Le 4 août au matin, les 1e, 2e 3e et 4e armées allemandes pénètrent en Belgique. Londres réagit immédiatement : le Foreign Office adresse un ultimatum à l'Allemagne, lui enjoignant d'évacuer la Belgique, en raison du traité de 1839 qui garantissait la neutralité de la Belgique. Pour Guillaume II et le chancelier Bethmann-Hollweg, la surprise est grande, car jusqu’au bout ils croient à la neutralité britannique. Le chancelier s'indigne devant l’ambassadeur Sir Edward Goschen (1847-1924) de ce qu'une nation parente puisse entrer en guerre pour « un chiffon de papier ». Rien n’y fait : au soir de cette journée, la Grande-Bretagne déclare la guerre au Reich.
À cette déconvenue du gouvernement allemand s'ajoute dans la journée le constat des défections de l'Italie et de la Roumanie, gouvernée par un roi Hohenzollern, qui choisissent la neutralité. Seul l’empire ottoman choisit le camp de l’alliance, mais pour le moment elle apparaît plus un fardeau qu’une aide
Conclusion
Dans un livre extrêmement pertinent (quoiqu'un peu tendancieux) et très documenté sur le sujet, l’historien australien Christopher Clark (Les Somnambules : Été 1914 : Comment l'Europe a marché vers la guerre, Paris, Flammarion, 2013, 668 p.) compare les dirigeants européens de 1914 à des somnambules : aucun n'a sciemment voulu la guerre... même si la plupart la souhaitaient au fond d'eux-mêmes, dans leur inconscient, pour se défaire de leurs peurs et se dégager de leurs impasses géopolitiques. Tels des somnambules qui marchent sans savoir où ils vont, tous se sont laissé piéger par leurs petites ambitions et c'est de la rencontre malheureuse de celles-ci qu'est née la conflagration.
Il est vrai qui si depuis plus de 30 ans l’Europe se dirige vers un conflit généralisé (armé ou non…) pour cause d’impérialisme, de nationalisme, de course aux armements, de concurrence économique de plus en plus acharnée, rien, absolument rien ne laisse présager l’emballement incontrôlable des quelques trois ou quatre années précédant la conflagration. Plus on s’approche du conflit, plus on semble plonger dans l’irrationnel, la paranoïa, la danse du funambule au dessus de l’abîme, le jeu de poker ou de la roulette russe. Ainsi :
• Cette guerre est déclenchée par l’assassinat d’un prince héritier plutôt pacifiste, slavophile, mais peu aimé à la cour qui ostracise son épouse roturière et dont la mort ne suscite pas un grand émoi dans la double monarchie.
• Cet assassinat passe presqu’inaperçu en Europe occidentale et personne ne se doute qu’à Vienne, à Berlin et à Saint-Pétersbourg les milieux bellicistes vont sauter sur l’occasion pour le transformer en casus-belli mondial.
• Il y a une disproportion flagrante entre la minuscule Serbie de 3 millions d’habitants et le géant austro-hongrois, état de 53 millions d’habitants… Voici un minuscule pays extrêmement provocateur, une sorte de mouche du coche, qui parvient, grâce au jeu d’alliances, à mettre le feu au monde.
• Cet attentat et ses conséquences révèlent toutes les failles de la diplomatie et du gouvernement allemand qui, de fait, n’a aucune ligne politique claire : l’empereur est un personnage fantasque et fanfaron, hyperactif inconstant, incapable d’avoir des visées à long terme et à s’y tenir : il devient rapidement le jeu de la rivalité entre civils et militaires de son gouvernement, ces derniers finissant par l’emporter.
• Les Allemands, spécialement les militaires sont assez lucides sur l’état des forces en Europe : il savent qu’en cas de conflit, ils devront se battre sur deux fronts, que l’armée austro-hongroise n’a de loin pas la qualité de l’armée du Reich, que celle de l’empire ottoman constitue plus un handicap qu’un atout, que la Grand Fleet surpasse à tous les niveau la Hochseeflotte et pourtant ils foncent tête baissée dans le conflit.
• Ces grands spécialistes de la chose guerrière que sont les brillants officiers prussiens de l’Obere Heeresleistung sont cependant nourris de préjugés qui s’avèreront lourds de conséquences : ils sont convaincus que l’Angleterre n’entrera pas dans le conflit : lourde erreur : tout, absolument tout indique que Londres ne restera pas les bras croisés, l’invasion de la Belgique n’étant que le prétexte… de même, ils sont convaincus que la lenteur de la mobilisation russe leur permettrait de battre la France, dans un délai assez bref et à condition de passer par la Belgique dont l’armée serait balayée en quelques heures : c’est pour cela qu’il n’ont échafaudé qu’un seul plan de guerre (plan Schlieffen)… Totalement déconnecté de la réalité, l’Etat-major général de l’armée allemande se promène dans l’irrationnel, à commencer par Moltke, persuadé que la France serait anéantie en 39 jours !
• A un moindre degré, l’état-major français envisage la guerre avec une inconscience similaire : galvanisé par la valeur retrouvée de l’armée française et de ses qualités d’héroïsme et de courage, il renonce à toute la prudence qui l’avait caractérisé jusqu’à présent au bénéfice de l’offensive à tout prix, persuadé qu’on gagnerait cette guerre à la hussarde et à la pointe de la baïonnette.
Voici, fin juillet 1914, une Europe de somnambules qui s’apprête à se suicider et qui, pistolet sur la tempe, prononce ces terribles mots que le chancelier du Reich adresse à son collègue de l’Etat-Major, Erich von Falkenhayn, le 4 août 1914 : « …wenn wir auch darüber zugrunde gehen, schön war's doch » « Et ma foi, si elle nous mène à l’abîme, cette aventure aura du moins été très belle ! »
« The lamps are going out all over Europe, we shall not see them lit again in our life-time ("Les lumières s’éteignent dans toute l’Europe, nous ne les reverrons pas s’allumer de notre vivant") » Sir Edward Grey (1862-1933), ministre du Foreign-Office, 3 août 1914.






